
|

|
|
Histoire de la Vendée du Bas Poitou en France |
||
|
|
||
| Chapitre Précédent | Table des matières | Chapitre Suivant |
|
SAINT LOUIS -EN POITOU. - SIÈGE DE FRONTENAY- ROHAN, BÉRUGES, FONTENAY-LE-COMTE, MERVENT ET VOUVENT.
|
|
Hugues X, comte; de la Marche, seigneur de Lusignan, obéissant aux impulsions dosa femme Isabelle, qui s'appelait orgueilleusement Comtesse et Reine, parce qu'avant d'épouser le comte de la Marche et d'Angoulême, elle avait appartenu en premières noces à Jean-Sans-Terre (1); et qui ne pouvait souffrir la pensée que son mari fut soumis à personne, résolut de profiter de la première occasion de se soulever contre la suzerainèté d'Alphonse et du roi son frère. De son côté ce dernier avait atteint, depuis le 23 avril 1236, sa majorité, et s'était déjà montré plein de prudence et de fermeté. - Alphonse, quoique plus jeune de quatre ou' cinq ans, se sentait fort d'un tel frère. Il habitait généralement Poitiers et s'y trouvait, en 1242, lorsque Hugues, toujours poussé par sa femme, qui ne lui pardonnait pas d'avoir reconnu en lui un maître, vint jusque dans le palais du comte lui déclarer insolemment qu'il ne le; reconnaissait plus comme son suzerain, pas plus que le, roi son frère, et qu'entre eux et lui, il en appelait désormais aux armes. Après ces paroles de colère, il disparaît, rejoint ses gens, met le feu à la maison qu'il avait habitée à Poitiers, et repart pour Lusignan. C'était une guerre déclarée; Louis ne la refusa point. Il passe en Poitou, ravage les terres du comte de la Marche, et prend ses meilleures, places. Hugues appelle à son secours son beaufrère Henri III, qui débarque à Royan et s'avance sur les rives de la Charente (2). Louis disposait d'une flotte de quatre-vingts navires équipés à la Rochelle, et de trente-mille hommes, Il marche à la rencontre des révoltés et les trouve rangés en bataille sur les bords du fleuve. Le monarque anglais s'était emparé du pont de Taillehourg ; il fallait enlever le poste ou traverser la Charente à la nage et sacrifier des milliers de soldats. Louis, suivi seulement de finit chevaliers, s'avance sur le pont, bravant les coups de l'ennemi. L'armée s'élance sur le chemin qu'avait frayé l'épée du roi et repousse les Anglais jusque sous les murs de Saintes. Poursuivant ses exploits, il ruine-les domaines seigneuriaux des Lusignan, détruit ce qui leur appartenait aux environs de, Poitiers, rase le château de Béruges et de. Montreuil-Bonnin, assiège et prend Frontenay-Rohan-Rohan, où s'était enfermé le ameux Geoffroy la Grand'Dent, terreur des moines de Maillezais et des environs et qui, quelque temps auparavant, avait pillé et détruit le château de l'Hermenault. Avant ce dernier assaut où fut blessé Alphonse, Geoffroy déserte son poste et court se réfugier à Fontenay. La terreur qu'inspirait le roi était telle, qu'après trois jours d'assaut, Fontenay, défendu par Geoffroy la Grand'Dent, lui ouvre ses portes (26 mai) (3). Mervent est pris également (4), et le roi le donne à Maurice Gallereau, avec la terre des Ouillères, confisquée sur Geoffroy, et lui promet en même temps de lui livrer en échange, s'il les retirait, Monzay (Deux-Sèvres), et Escoué, en la paroisse de Montreuil (5). Quatre jours après, Vouvent avait le même sort que Mervent (6). La réconciliation dut s'opérer à quelques mois de là, et Geoffroy rentrer en grâce avec son suzerain, car nous le voyons, en avril 1213, rendre foi et hommage à Alphonse, pour les châteaux de Mervent et de Vouvent, et les fiefs de Fontenay et de Soubise (7). Plus tard, Mervent et Vouvent passèrent aux Parthenay l'Archevesque et aux de Rohan, qui ont produit une foule de guerriers fameux et de femmes célèbres. Une trêve de cinq ans fut conclue entre les deux rois, et un des résultats de cette guerre fut que Saint Louis ordonna aux seigneurs poitevins qui possédaient des fiefs en même temps en France et en Angleterre, d'avoir à choisir entre les deux pays; un même vassal ne pouvant avoir à la fois deux suzerains. Les seigneurs s'y conformèrent, et désormais aucun de ceux du Poitou ne dépendit d'aucun seigneur d'outre-mer (Mathieu Paris, ad anno 124? (8).
|
|
NOTES: (1) Toutes les chroniques. (2) D'après une enquête de l'an 1255, Thibault-Chastaigner, seigneur de la Meilleraye, de Réaurnur, etc., et ses deux fils, auteurs de la branche des seigneurs du Breuil, de Challans, la Jarrie et Saint-Fulgent, embrassèrent le parti de Saint Louis et du comte Alphonse, son frère, dans la guerre que ces princes soutinrent, en 1241, contre Hugues, de Lusignan, au sujet de l'investiture du Poitou (BeauchetFilteau, page 622). (3) L'armée de Saint Louis campait dans le champ de foire actuel, (4) On montre encore, à gauche du vieux château, les rochers où, selon la tradition, aurait campé le roi de France. (5) archives de Fontenay. T. I, page 95. (6) Le château de Pouzauges était également remis à Saint Louis, qui y mettait une garnison, sous le commandement du sire de Châteaubriant, qui promettait de le remettre au roi à, première réquisition. (Archives de Fontenay, T. I, page 97 - mai 1242.) Les mômes archives font connaître que Saint Louis était a Vouvent le 30 mai et le 6 juin. (7) Archives de Fontenay, T. 7, page 103. - Original, - Archives nationales, carton J, 490. - La paix avait été signée avec Hugues de Lusignan, devant Pons, au mois d'août 1242. (8) En 1249, les Juifs étaient chassés du Poitou, et pendant la cinquième croisade, notre pays fut administré par Blanche de Castille, aidée de Philippe, trésorier de Saint-Hilaire, maître Renaud, homme de loi, et Guillaume d'Esnancourt (Antiquaires de l'Ouest, III, 407 et suivantes).
|
|
EXCOMMUNICATION DE GEOFFROY
DE LUSIGNAN DIT LA GRAND' DENT. TOUTE PUISSANCE DES PAPES.
|
|
Geoffroy Ier, frère de Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, après s'être couvert de gloire devant Saint-Jean-d'Acre, en 1180, était revenu avec le titre de seigneur de Jaffa et de Césarée en Poitou, où il entretenait une suite nombreuse de routiers, avec lesquels (chose inconcevable), il se ruait de préférence sur les abbayes et les prieurés. Maillezais était surtout le monastère, sur lequel il s'acharnait le plus volontiers, et, sa mort avait été accueillie avec un vrai plaisir. Son fils Geoffroy II, dit la Grand'Dent (1), devait marcher sur ses traces et dépasser même les horreurs commises par son père. Pendant de longues années, l'abbaye de Maillezais est pressurée et ses biens ravagés : l'abbé Guillaume III, surnommé le Fort, se décide à mettre fin à la persécution et il déclare en personne, au, terrible baron, qu'il s'opposerait énergiquement à la continuation de ses violences, mais rien n'y fait, Guillaume aggrave ses exactions, poursuit de sa haine tous les autres monastères, notamment celui de l'Absie. L'abbé .Guillaume se rend à Rome, et obtient du Pape Honorius III, que le spoliateur serait puni des peines canoniques, mais à son retour il meurt. Geoffroy envahit de nouveau le monastère; de Maillezais, et le pille. Les moines, sous la conduite de leur nouvel abbé Raynaud ou Baynald, abandonnent l'abbaye, et à travers plusieurs lieues de marais, arrivent à Niort où ils reçoivent un asile. Le châtiment ne devait pas se faire attendre plus longtemps ; sur les réclamations de Raynald, Grégoire IX lance contre le puissant seigneur une bulle d'excommunication qui le met en interdit. Quand Geoffroy paraît, les flambeaux s'éteignent, le service divin cesse, la foule s'écoule, les temples, sont fermés... A cette époque de foi profonde, l'interdit était une arme redoutable entre les mains des papes, et Geoffroy, obligé comme les plus puissants rois du moyen âge, de s'humilier devant la tiare pontificale, signe à Spolète un traité, en vertu duquel l'île de Maillezais tout entière, Souil et Chalais, sont libres de toutes redevances, coutumes, juridictions auxquelles il prétendait. Ce traité concède aussi aux Frères de l'Aumônerie, près Fontenay, un droit de chauffage dans la forêt de Mervent. L'excommunication est levée (1 juillet 1232). Mais préalablement à son départ pour Rome, il avait dû prouver son repentir et réparer les maux qu'il avait causés. C'est sans doute; dans ce dessein que fut écrite la charte traduite par Apollinaire Briquet, et dont nous donnons un extrait : " A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Geoffroy de Leziniem, vicomte de Châtellerault, seigneur de Volvent et Mayrevant, salut éternel. Vous saurez que, étant sur le point de prendre le chemin de la cour de Rome, pour terminer mes différents avec l'église de Maillezais, j'ai voulu, avant mon départ, satisfaire, autant qu'il en est. en mon pouvoir, tous: ceux qui ont à se plaindre de moi, et surtout, les hommes qui professent la vie religieuse; ce qu'ayant entendu Geiffroi, abbé de l'Absie, il est venu près de moi et m'a demandé réparation des dommages, pertes et injures que moi et mon père avons fait éprouver au monastere et aux moines de l'Absie. J'ai appris par le témoignage de gens (lignes de foi, que ces plaintes étaient justes... Alors pour le remède de mon âme et le salut de mes parents... j'ai satisfait... 1232 (2). " (1) Geoffroy était ainsi nommé parce qu'il avait une dent si. longue, qu'elle sortait de sa bouche. - Une médaille singulière qui, d'après Millin (Voyage dans les départements du midi de la France) n'aurait pas été connue du savant Mazet, ancien bénédictin, représente d'un côté le comte Geoffroy II, coiffé d'un casque singulier attaché avec une mentonnière ; une grande dent sort (le sa bouche et on lit autour de a pièce : Godefridus de Lusinem. Il y a sur le revers de la médaille, la tête d'un animal monstrueux. Tentzel, qui, le premier a décrit cette médaille, dans un ouvrage extrêmement rare, dit que l'histoire de Geoffroy, a Grand' Dent, a été traduite du français en italien et de l'italien en allemand en 1456, par les ordres du margrave Rodolphe de Hochberg. On y lit que deux chevaliers aragonais vinrent inviter le brave Geoffroy a, aller combattre un monstre, gardien d'un trésor qui avait été amassé par quelqu'un de sa maison. Quoique cet animal eût déjà dévoré un chevalier anglais qui vouait, l'attaquer, Geoffroy n'hésita pas de tenter l'aventure, nais il mourut de maladie, avant d'avoir pu joindre le monstre. Cette médaille aura été frappée dans le XVe siècle par quelque seigneur de la maison de Lusignan, qui a voulu honorer a mémoire d'un de ses, plus illustres ancêtres.
|
|
NOTES: La tête du monstre est celle de celui que Geoffroy aurait certainement vaincu, si la mort ne l'avait prévenu. (2) Histoire du Poitou, - Prières justificatives, t. n, page 483.
|
|
CONCESSION D'UN DROIT AUX
FRÈRES DE L'AUMONERIE DE FONTENAY, AUTRES EXCOMMUNICATIONS, EXCOMMUNICATIONS DIVERSES, MOUCHAMPS - EXCOMMUNICATION
|
|
Deux ans après, le terrible Geoffroy concédait aux frères de Saint-Lazare de l'Aumônerie de Fontenay, le droit de prendre dans la forêt de Mervent, le bois nécessaire à leur chauffage (1) Geoffroy mourut sans postérité en 1248, et fut inhumé dans l'église de Vouvent, où il avait fondé une chapelle (2). AUTRES EXCOMMUNICATIONS Avant Geoffroy la Grand'Dent, les seigneurs laïques de Mouchamps et de Puybelliard, avaient été frappés des mêmes peines canoniques que lui, et comme lui, avaient du céder devant cette force morale, qui au moyen âge surtout fut redoutable, et souvent aussi, disons-le, utile. EXCOMMUNICATIONS DIVERSES Le Puybelliard. Le prieuré de Puybelliard, dépendant de la célèbre abbaye de Marmoutiers de Tours, avait un dangereux voisin en la personne du vicomte de Thouars, le plus puissant vassal du comte de Poitiers. Il n'y avait pas de vexations qu'il n'essayât sur les pauvres moines, saisissant leurs revenus, pillant leurs terres, enlevant leurs serfs, s'appropriant les blés de leurs semis. Mais un jour de l'année 1186, une feuille de parchemin expédiée de Vérone et portant le sceau du pape Urbain III, fit tomber tout à coup les prétentions tyranniques du seigneur vicomte. C'était une bulle du serviteur des serviteurs de .Dieu à ses chers fils les archiprêtres de Tours et d'Amboise. Voici quelques passages de cette bulle : " Des excès de cette nature ne devant pas être encouragés par une coupable négligence, nous mandons à votre discrétion par les présentes lettres apostoliques, d'admonester très formellement ledit vicomte, pour qu'il restitue ce qu'il a pris, indemnise convenablement les religieux et leurs sujets du tort et des injures qu'il leur a faits, et se désiste dorénavant de tout excès à-leur égard. S'il prétend n'avoir agi qu'en vertu de son droit, examinez l'affaire et jugezlà de suite, et dans le cas où il refuserait, par hasard, de se soumettre à votre admonestation ou sentence, sans vous laisser arrêter par aucun appel formé par ledit vicomte, enchaînez-le dans les liens de l'excommunication et traitez-le en excommunié, défendant à qui que ce soit de l'approcher, jusqu'à ce qu'il vous ait donné pleine satisfaction " (3). MOUCHAMPS. - EXCOMMUNICATION En 1154, le seigneur de Mouchamps, Airaud, établit dans son château situé près de l'église, et sur le sommet du rocher qui domine la pittoresque vallée du Petit-Lay, un pressoir auquel il veut contraindre tous ceux qui possèdent des vignes à apporter leurs vendanges. C'était pour lui un facile moyen de remplir son. cellier des meilleurs vins du cru, sans qu'il lui en contât beaucoup. Les manants courbèrent la tête, mais les moines de la Grenetière, par l'organe de Thomas, leur abbé, réclamèrent près de l'évêque de Poitiers Calon ? qui fit cesser, par une bonne excommunication, les exactions; du seigneur de Mouchamps (4).
|
|
NOTES: (1) L. Brochet. - Voir la charte dans l'Histoire de la forêt de Vouvent page 29 (2) Geoffroy, , la Grand'Dent, serait le fils d'Eustaehe Chabot, fille de Thibaud-Chabot III, sire de Vouvent, de Rocheservièré et de la Grève, poétisée sous le noue de fée Mélusine. (3) Extrait d'un travail de M. Paul Marchegay. (4) C'est dans les vignobles de la Tranchelandière et de Grandry, que les moines récoltaient leurs meilleurs vins. -De a charte latine analysée par M. Marchegay, il résulte qu'Airaud et l'abbé de la Grenetière comparurent devant l'évêque de Poitiers à Pareds, aujourd'hui simple village de a commune de a Jaudonnière. (Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, année 1857.)
|
|
LA LÉGENDE DE MÉLUSINE
|
|
Les érudits veulent que les châteaux-forts de Mervent, de Pouzauges, de Tiffauges, de Châteaumur et de Vouvent aient été bâtis vers le XIIe siècle, mais les paysans vendéens ont oublié l'histoire ; ils ne connaissent que la légende et la racontent volontiers aux voyageurs. A une certaine époque, ces châteaux s'élevèrent au-dessus du sol, presque en même temps et avec une rapidité merveilleuse, saris le secours d'aucun ouvrier. Quelle était la main qui dressait ainsi, et comme par enchantement, ces donjons crénelés et redoutables, derrière lesquels devaient s'abriter de puissants seigneurs. Personne ne le savait : le travail se faisait la nuit, Un soir, un homme de Pouzauges, pour découvrir le mystère, se cacha dans les broussailles, au pied du bois de la Folie, non loin de- la' tour carrée à trois étages qui, quoique démantelée, brave encore impunément la fureur des vents et des intempéries. A minuit sonnant, une fée, blanche apparition des nuits, parut : c'était la Mère Lusine qui, seule,, sans secours humain, montait pierres et ciment et parachevait ce monument gigantesque. Honteuse d'être découverte, elle s'enfuit en criant : Poudauq, Tiffaug, Mervent, Châteaumur et Vouvent, irant chaqu' an, j' le jure, d en pierre en périssant. Depuis lors une pierre se détache chaque année de ces cinq forteresses. Les corneilles, voltigeant le jour sur les ruines, croassent et se lamentent sur cette malheureuse destinée, tandis que des bêtes fantastiques et des lutins narquois font des niches aux hommes qui se hasardent à visiter les ruines au clair de lune. Mélusine était une princesse, fille d'un roi d'Albanie et d'une fée. Elle habitait au fond de la forêt du Colombier, près Lusignan. Un jour que Raymondin, comte de Poitiers, chassait à courre à travers bois, il perdit la chasse et s'égara dans les fourrés. La nuit tombait, et le comte était fort en peine de retrouver son chemin, quand il arriva dans une clairière où une fontaine bouillonnait au fond d'une vasque de pierre. A la clarté naissante de la lune, il aperçut tout à coup une bande de jeunes filles, nues jusqu'à mi-corps, qui prenaient leurs ébats dans l'eau limpide et, parmi elles, une jeune dame d'une surprenante 'beauté : ses magnifiques cheveux blonds ruisselaient sur ses blanches épaules et elle les peignait avec un peigne d'or. Cette princesse accueillit grès gracieusement Raymondin. Elle lui fil servir à souper par ses dames d'honneur et, au dessert, sous la bleuâtre lumière de la lune, ils fleuretèrent doucement ensemble. Raymondin; très amoureux, demanda la main de la dame, qui n'était autre que Mélusine, et elle la lui accorda à une seule condition ; c'était que tous les samedis, il la laisserait absolument libre de s'enfermer chez elle et ne chercherait jamais à savoir ce qu'elle y ferait. Comme les gens passionnément épris, le comte promit tout ce qu'on voulait et, peu de jours après, les noces furent célébrées en grande pompe à Poitiers, bien que la famille de Raymondin vit, sans enthousiasme,- s'installer dans le palais du comte très chrétien' cette étrange épousée, trouvée au fond d'un bois. 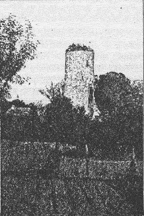 La tour Mélusine à Vouvent (Cliché d M. Rabaud) Comme cadeau nuptial, Mélusine construisit à Lusignan un château princier, dont les murailles, comme à Tiffauges, Pouzauges et Vouvent. s'élevèrent comme par enchantement. Les jeunes mariés vinrent y habiter, et au bout d'un an, la princesse mit au monde un fils qui n'avait qu'une dent, mais une dent phénoménale, qui lui valut le nom de Geoffroy à la grand'dent. L'année d'après nouvelle grossesse cette fois, Mélusine accoucha d'un garçon qui n'avait qu'un œil au milieu au milieu du front. Plus tard, un autre garçon naquit, et ce fut encore un être exceptionnel, car il n'avait qu'une oreille. Tout en adorant sa femme, Raymondin commençait à s'effrayer de cette succession de monstres, et se trouvait fort mortifié, lorsque les gens de son entourage lui adressaient d'hypocrites compliments de condoléance. Au quatrième enfant phénomène., il confia sa tristesse à son frère cadet. Celui-ci lui dit qu'il y avait là-dessous quelque diablerie, et demanda à son aîné si, par hasard, sa femme n'était pas une sorcière. Raymondin alors, avoua que, tous les samedis, la princesse s'enfermait dans sa chambre pendant vingt-quatre heures, et qu'on ne savait trop à quoi elle employait son temps. " Il faut le savoir, insinua l'autre, c'est un cas de conscience; elle s'y livre sans doute à quelques maléfices, et de là viennent tous tes malheurs. " Le samedi suivant, les deux frères se dirigèrent à pas de velours vers la chambre de Mélusine; Raymondin regarda par le trou de la serrure et ce qu'il vit le stupéfia grandement. - Nue et blanche comme un lis, Mélusine se baignait dans un vaste réservoir; elle chantait en peignant .ses admirables cheveux d'or, et le comte découvrit que son corps se terminait eu queue de serpent. C'était pour que personne ne se doutât de cette cruelle transformation hebdomadaire. que la fée se claquemurait tous les samedis dans son boudoir. " L'heureux homme, s'écriait à ce propos ce pince-sans-rire de Henri Heine, l'heureux mari, dont la femme n'était serpent qu'à moitié ! " Raymondin n'apprécia pas ce bonheur, car d'un furieux coup d'épaule il enfonça la porte de la chambre. A l'aspect de ce mari courroucé, Mélusine poussa un cri de désespoir, s'évanouit dans l'air et, depuis ce temps-là, on ne la revit plus. Parfois, cependant, les nuits de lune, on l'entendait voler et chanter plaintivement autour du château qu'elle avait bâti ; même, elle pénétrait dans le dortoir des enfants et les berçait doucement dans leur lit (1). La légende veut qu'elle soit aussi revenue dans ses autres châteaux, mais seulement dans des occasions importantes et pour annoncer, par des cris effroyables, de terribles calamités, principalement lorsque quelques seigneurs de la maison de Lusignan, ou quelqu'un des rois de France étaient menacés de la mort. On prétend l'avoir entendue avant celle des rois Henri IV et Louis XIII, et les mères ne cessent encore de répéter ces récits aux petits enfants qui pâlissent d'effroi en les écoutant. Quel beau sujet de féerie fournirait la légende si poétique de .Mélusine. |
|
NOTES: (1) Au pays de Mélusine, par André Theuriet. Le Journal du mercredi 11 mars 1896.
|
|
FONTENAY RÉUNI AU
DOMAINE D'ALPHONSE. HOMMAGE DE DIVERS SEIGNEURS. GOUVERNEMENT PATERNEL D'ALPHONSE. - SA MORT. PHILIPPE LE HARDI EN BAS-POITOU (1272).
|
|
Louis IX réunit Fontenay aux autres domaines d'Alphonse, son frère. Ce changement de maître (1) donna à la ville une importance qu'elle avait été jusque-là loin d'atteindre. Seule place un peu forte des possessions privées du frère du roi, dans cette partie du Poitou, elle devint par cela même le centre féodal de la contrée. Aussi, sépara-t-on de la mouvance de la tour de Maubergeon de Poitiers pour les joindre à la sienne, Talmond, Olonne, Curzon, Champagné-les-Marais, Luçon, le Petit-château de Vouvent et Coulonges-les-Royaux. On y établit un sénéchal ayant droit de juridiction supérieure sur tous ces fiefs, et elle s'appela désormais Fontenay-le-Comte (Fontiniacum comiti. La Fontenelle avait recueilli un fragment d'inscription placé autrefois dans l'un des murs du palais de, justice, et qui avait, appartenu à l'édifice bâti sous Alphonse; pour y tenir les assises. Le nom d'un sénéchal ou de. tout autre officier. du comte ayant fait exécuter les travaux,, remplissait, le vide laissé par la cassure (2). (N. . . du comte de Poitiers et de Toulouse m'a fait faire). Alphonse traita en souverain juste et équitable tousses sujets, et en particulier les bourgeois, de la nouvelle capitale du Bas-Poitou, augmenta leurs privilèges et leur permit d'entrer dans cette voie de prospérité qui, malgré bien des, entraves dont. nous parlerons plus tard, ne s'arrêta qu'au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Avant de partir pour la Terre Sainte en 1268, il rédigea, ainsi que sa femme le monument de ses dernières volontés. Par cet acte ils affranchirent leurs serfs et leurs enfants quels qu'ils fussent (3). Alphonse étant mort le 21 août 1271 (4), au château de Cometo en Toscane, le Poitou fit retour au roi qui le conserva pendant quarante années consécutives. Le neveu d'Alphonse, Philippe le Hardi, vint en Poitou l'année suivante (5), et notamment à Fontenay-le-Confite, où il confirma les privilèges accordés par saint Louis, à la ville de Niort. En revanche, il se montra peu généreux pour la ville qui lui donnait l'hospitalité. Il octroya pourtant, en 1282, à JeanBloynyen, bourgeois de Fontenay, " qui tenait du roi à foy et homage, le criage et coustume du vin vendu à détail en la ville dudit Fontenay, elle droit de l'avoine demoura au roy, etc.." Cette charte contenue en partie dans l'Inventaire des titres de Notre-. Dame, établit que c'est à partir de 1282, que la ville perçut à son bénéfice les droits de vente en détail du vin, qui jusque-là avaient toujours appartenu aux seigneurs ; elle complota la concession faite au mois de mars 1268 (6) par Alphonse, concédant aux habitants le banc ou estal du vin qui se vendait en détail. En 1269 il avait fait don de 40 sols à la Léproserie de Saint-Thomas, et de pareille somme à l'Hôtel-Dieu, fondé vers le commencement du XIIIe siècle, dans les Loges (7).
|
|
NOTES: (1) Au mois de février 1246, Raoul de Mauléon cédait à Alphonse, tous les droits qu'il avait sur le domaine de Fontenay, et au mois de mars 1248, Alphonse donnait son acquiescement à l'achat par Sebrand-Chabot de l'Herbergement de l'Alberterie, sis au faubourg des Loges, à lui vendu par Girard-Voussard, Au mois de juillet 1253, Aimery de Thouars, Aimery de Rochechouart et Geoffroy de Tonnay, agissant au nom de ses filles, se reconnaissaient les hommes liges d'Alphonse, pour les terres provenant de a succession de Raoul de Mauléon, à ceux abandonnées par le dit comte. - Archives de Fontenay, Tome i, pages 111-117-119. (2) Peut-être était ce l'un de ceux de Adam Pannetier ou de Renaud Guionnet, qui furent sénéchaux d'Alphonse à Fontenay, de 1241 à 1258. On fit des travaux eu local de a juridiction en 1243. - Fillon. Poitou-Vendée, Fontenay, page 29. (3) Avant de partir pour a Palestine, Alphonse avait écrit trois lettres au sénéchal du Poitou, pour lui demander de réunir, les fonds nécessaires à son voyage. Les lettres. datées de 1269, septembre 1269 et 28 janvier 1270, se trouvent aux Archives de Fontenay, T. I, pages 165, 171 et 175. (4) Antérieurement à a mort de son oncle, et a la date du 20 mars 1271, Philippe le Hardi avait enjoint au sénéchal de 'Poitiers, de vider un différend survenu entre Thibaut-Chasteigner et Guillaume Incard, au sujet du cimetière de saint-Pierre. - Archives de la seigneurie de Saint-Michel-le-Cloucq, Fontenay, T. I, page 183. (5) En 1371-1272, Guillaume de Parthenay l'Archevêque, seigneur (le Parthenay, Mervent, Soubise, Mouchamps, etc., accompagna le roi- Philippe le Hardi, avec cinq chevaliers, contre le comte de Foix, bien qu'il fut mineur, et eût pu refuser le service qu'on réclamait de lui. Il mourut vers 1308, en désignant sa sépulture dans l'abbaye de a Grenetière, qu'il affectionnait beaucoup. - Benj.-Fillon, page 495. (6) En cette même année 1268, le seigneur de la Chaize-le-Vicomte, Geoffroy de Châteaubriant, ayant envahi les terres de Belleville, fut de ce chef, condamné à une amende de 2.800 livres. (7) Les archives de Fontenay, T. I, pages 189 à 194, contiennent les noms des habitants de Fontenay, qui s'étaient cotisés pour aider à la reconstruction de l'Hôtel-Dieu de Fontenay, sous le règne de Philippe le Hardi, ce qui indique que les travaux n'étaient pas encore terminés.
|
|
INONDATION A FONTENAY.
- CONSTRUCTION DE L'ACHENEAU NEUF. ]RECTION DE FONTENAY EN SIÈGE ROYAL.
|
|
Ce fut sous le règne de ce prince, que se passa l'événement suivant, raconté par la Chronique du Langon. Le Both de l'Anglée creusé pour dessécher les prairies de Velluire n'avait qu'une levée d'une grande épaisseur, assez haute pour résister aux eaux de la Vendée. Presque en même temps, une autre levée fut construite pour se rendre à Notre-Dame de Coussaye, qui se trouve aujourd'hui isolée au milieu de la plaine, près du Poiré-de-Velluire. Les eaux de la Vendée, trop resserrées pour pouvoir passer facilement sous les arcades du pont de la Craverne, refluèrent vers Fontenay et inondèrent les Loges qui étaient déjà le faubourg industriel de la ville. A. la suite d'une crue exceptionnelle, et pour éviter leur ruine, les Fontenaisiens s'assemblèrent, et la nuit, allèrent secrètement rompre les chaussées du Pontreau et du Both de l'Anglée. Cet événement décida de la construction du canal, dit de l'Acheneau neuf ou canal du Roi, allant du Both de l'Anglée à Luçon, et qui fut terminé vers 1283 (1). Cette même année (1283), un arrêt du Parlement maintenait le roi de France en possession des comtés de Poitou et d'Auverge, réclamés par Charles de Sicile, frère de saint Louis et d'Alphonse (2). Son successeur, Philippe le Bel, érigea Fontenay en siège royal à la fin du XIIIe siècle, puis plus tard, en décembre 1311 (3) le donna avec le Poitou à son fils puisé Philippe le Long. Celuici étant devenu roi en 1316, en fit présent avec Niort, Mont-morillon et autres terres en accroissement d'apanage à son frère Charles, comte de la Marche (4). C'est à ce Charles de la Marche que l'on doit l'agrandissement de la Maladrerie fondée au XIIIe siècle, pour séparer des autres hommes les malheureux atteints de la lèpre(5). C'est durant cette période, dernières années du XIIIe siècle et premières années du XIVe siècle, que fut rédigé le Grand Gauthier, précieux manuscrit dressé par un évêque de Poitiers, ancien moine cordelier et docteur en théologie.
|
|
NOTES: (1) Le canal du Roi fut creusé aux frais des communes d'Auzais. de Petosse, de l'Hermenault, de fouillé, de Saint-Valérien, de Saint-Laurent de a Salle, du Poiré, du Langon, de Mouzeuil, de Nalliers et de Sainte-Gemme-la-Paine. (2) Archives de Fontenay. -T. I, page 195. (3) Huit ans auparavant, Maurice de Belleville, seigneur de Montaigu et de a Garnache, fut un de ceux des seigneurs poitevins qui se rendirent en 1303, aux armées de Flandre, d'après le mandement du roi Philippe le Bel, et qui se couvrirent de gloire à a funeste bataille de Courtray, où périrent vingt-mille Français. Il fut, par sa fille Jeanne, le grand-père du fameux connétable Olivier de Clisson. (4) Cette session empêcha, l'année suivante Fontenay d'être le siège d'un évêché, lors de la création de ceux de Luçon et de Maillezais. (5) Jean Parthenay l'Archevêque, seigneur de Parthenay, Vouvent, Mouchamps. etc., fut en 1321-22, lors de la, peste qui désolait le Poitou, un des seigneurs qui poursuivaient avec le plus d'acharnement les Juifs et les lépreux, que a voix .publique accusait d'avoir empoisonné les sources.
|
|
LE GRAND GAUTHIER
|
|
C'est à Gauthier de Bruges, évêque de Poitiers, dont les démêlés avec le pape Clément V furent retentissants, que l'on doit, vers 1307, un Pouillé du diocèse de Poitiers, connu sous le nom de Grand Gauthier ou Gautier, parce qu'il le dressa pour établir nettement et incontestablement l'ordre à mettre dans les choses de son église. C'est une nomenclature de tous les bénéfices du diocèse, de leurs conditions d'existence, leurs collateurs, les perceptions à y faire, l'ordinaire ou autres bénéfices simples qui en dépendaient. Là se trouvent des notions qui, sans lui, n'eussent probablement jamais été connues. Ce livre était d'une grande importance pour le diocèse de Poitiers et pour l'évêché, puisqu'il énumérait tous les titres de cette vaste église, et' mentionnait les obligations de chaque titulaire, les droits réservés à l'évêque et tous les actes concernant les domaines de l'évêché. Ce livre, si précieux aujourd'hui et si utile à notre histoire bas-poitevine, a eu des fortunes diverses. Il avait disparu dès le temps de Gautier, soustrait sans doute par une main infidèle intéressée. L'histoire accuse de ce fait un certain André, doyen de Talmont, qui avait profité, pour le faire disparaître, de la vacance du siège entre Gauthier, ancien moine, et son prédécesseur. Gauthier, fort soucieux des soins dont il prenait la charge et qui, sans doute, avait pu comprendre l'utilité pratique de ce Pouillé, s'empressa de le reconstituer à force d'enquêtes et de recherches laborieuses, et quand il l'eut achevé, il mit en première page, afin d'authentiquer tous ces renseignements, une lettre à son successeur pour lui faire connaître l'histoire de ce livre, comment il avait disparu et comment lui, Gauthier, s'était donné la peine de le refaire. IL affirmait que tout y était conforme à la vérité et qu'on devait s'en rapporter à cette publication comme à l'original lui-même (1). Par suite de circonstances restées inconnues, il tomba, versa le premier quart du XIXe siècle, aux mains d'un connaisseur qui le garda jusqu'à sa mort et dont les héritiers le cédèrent, en 1841, à la Bibliothèque de Poitiers, où il est fréquemment consulté par ceux qu'intéressent ces matières (2).
|
|
NOTES: (1) Aillery. - Pouillé de Luçon. pp. 1 et 108. (2) Archives historiques du Poitou (Vol. XXV et suivant. (Auber, T. IX, pages 98 et 99
|
|
ÉRECTION DE LUÇON
ET DE MAILLEZAIS EN ÉVÊCHÉS (1317)
|
|
L'évêque de Poitiers, qui étendait sa juridiction non seulement sur toute la province de ce noie, mais aussi sur les confins des provinces voisines, ne pouvait, malgré tout son dévouement, suffire à l'administration d'un aussi vaste diocèse. Le pape Jean XXII, d'accord avec le roi de France, comprit que l'étendue du diocèse de Poitiers était trop considérable pour un seul homme, et par bulles données à Avignon aux ides d'avril 1317, ii décida la création d'évêchés nouveaux à Luçon et à Maillezais, qui étaient de florissantes abbayes. Le nouveau diocèse de Poitiers comprenait à peu près ce que l'on est convenu d'appeler le Faut-Poitou. Celui de, Luçon avançait jusqu'au delà Clisson, avoisinant par un point la Sèvre Nantaise, et cotoyait l'Océan. Il comprenait les doyennés d'Aizenay, de Mareuil-sur-le-Lay, de Montaigu ; l'archiprétré de Pareds, le doyenné de Talmond, soit environ 255 paroisses, 13 abbayes et nue quantité de prieurés. Le premier évêque fut Pierre de la Voirie, abbé du monastère- de Luçon depuis quinze agis. L'évêché de Maillezais comprit l'archiprêtré d'Andin, les doyennés de Bressuire, de Fontenay-le-Comte, de Saint-Laurent et de Vihiers, soit 228 paroisses, 9 abbayes et 148 prieurés. Geoffroy Pouvreau, fut, ainsi que nous l'avons déjà dit, le premier évêque de Maillezais, après avoir été longtemps abbé de ce monastère. Il fut sacré à Avignon le 20 novembre 1317. Disons en passant que les titulaires de ce dernier siège résidèrent presque constamment dans le prieuré de Saint-Hilairede-Fontenay, dont l'air était paraît-il beaucoup plus sain que celui des marais de Maillezais (1) et aussi à l'Hermenault. Le 22 avril 1630, une bulle du Pape Urbain VIII transférait à Fontenay le siège épiscopal de Maillezais, et le 11 janvier de l'année suivante, une autre bulle sécularisait le monastère de Maillezais, de l'ordre de Saint-Benoît, et érigeait un chapitre séculier à Fontenay (2) ; mais ces bulles ne furent pas suivies d'effet, l'échevinage et la magistrature s'étant opposés de toutes leurs forces à l'établissement de l'évêché si- près d'eux. Le 2 mai 164.8 (3), Innocent X enlevait à Maillezais soit titre de cité, et transférait le siège épiscopal à la Rochelle, en appelant à ce poste Raoul de la Guibourgère, déjà évêque de Maillezais. La bulle du pape et l'ordonnance du roi furent enregistrées au parlement, le 7 septembre 1650, mais elles ne reçurent leur entière exécution qu'en 1656, et encore les lettres royales confirmatives de la translation, ne sont-elles que du 20 mai 1664 (4). Raoul mourut le 15 mai 1661, à l'âge de 72 ans, et fut inhumé dans l'église du couvent des Capucins de Fontenay, établi sur l'emplacement de l'ancien hôtel Bélesbat, acheté par les moines à Claude d'Aubigné le 27 janvier 1632 (5).
|
|
NOTES: (1) Le sceau en bronze de l'abbaye de Maillezais a été retrouvé en 1854 dans les fondations du moulin du château de Fontenay. Il est antérieur à 1317. (2) Archives de Fontenay. - T. IV, pages 9-17 et 19-39. (3) Archives de Fontenay,. T. IV, page 171. (4) Archives de Fontenay, T. iV, pages 231, etc. (5) Archives de Fontenay, T. IV, page 51.
|
|
MORT DE PHILIPPE LE LONG
- RÈGLEMENTS DE POLICE (1343)
|
|
Philippe le Long étant mort le 3 janvier 1322, son frère Charles le Bel, comte de la Marche, lui succéda, et ses domaines se fondirent alors dans ceux de la couronne. Le règne de ce prince et les premières années de celui de Philippe de Valois qui lui succéda en 1328 (1), n'offrent guère d'événements particuliers au Bas-Poitou, et il faut arriver à 1343, pour retrouver quelques souvenirs. Disons seulement que Louis de Thouars, 22e vicomte et seigneur de Talmont, etc., servit dans l'armée de Philippe de Valois en qualité de seigneur banneret en 1338-39-40 et 41. Des règlements de police pour Fontenay, conservés dans l'inventaire des titres de Notre-Dame, et qui remontent au 21 octobre 1343, sont de la plus grande sagesse, et quelques-uns ne seraient pas désavoués aujourd'hui. Ces règlements, élaborés à Niort par plusieurs prélats, gens d'église, bourgeois, conseillers et avocats, sous la présidence de Jourdain de Loubert, conseiller du roi, gouverneur du roi et sénéchal de Poitou et de Limouzin, nous apprennent une foule de particularités sur l'organisation de la localité, sur les poids, le mesurage, la poissonnerie, la boulangerie, etc. (2) Ces documents nous font connaître notamment qu'une famille Billaud exerça, au carrefour de la Fontaine, les fonctions de notaires, depuis environ 1300, jusqu'au règne de Charles VIII (1483), et qui avec d'autres assez nombreuses, formait dès le XIIIe siècle, une sorte de bourgeoisie.
|
|
NOTES: (1) Deux ans auparavant, le 4 décembre 1326, Jehanne de Saint-Vincent, veuve de Thibaud-Chabot et sa fille Perrine, fondaient au faubourg Saint-Martin de Fontenay, un couvent de religieuses de Sainte-Claire, (Archives de Fontenay, T. I, page 220 bis). - La seconde fondation fut faite le 18 janvier 1460 par Catherine Terroille, veuve de Méry Berlin; page 331. (2) Fillon. - Recherches sur Fontenay, T. i, page 47. Une cloche fondue en 1350 pour Notre-Dame, fut envoyée à l'hôtel de la monnaie de la Rochelle, en janvier 1793.
|
|
ETAT LITTÉRAIRE, SCIENTIFIQUE ET SOCIAL DU POITOU AU COMMENCEMENT DU XIVe SIÈCLE
|
|
La sagesse de Saint Louis et de son frère Alphonse, comte de Poitiers, l'équité de Charles IV, les chartes octroyées par ces nobles princes, et aussi par Philippe le Hardi, les liens plus étroits que les Croisades avaient créés entre les grands seigneurs et leurs vassaux, l'adoucissement des mœurs, l'accroissement du nombre des propriétaires du sol dû à la plus grande facilité d'acquérir, le zèle louable dont faisait preuve une grande partie du clergé, pour établir entre toutes les classes de la société l'amour fraternel, avaient fait du Bas-Poitou, une des plus riches contrées de la France (1). Cette contrée, qu'une pensée religieuse avait rempli d'enthousiasme, qui à la voix d'un ermite s'était rangée sous la bannière des preux, avait-senti souffler sur elle, comme une émanation d'Orient, une littérature toute naïve et chevaleresque, et' quelques poitevins obtenaient l'honneur si envié alors de s'entendre appeler poètes provençaux. - C'était vers la cour de Toulouse ou les grandes cités méridionales, que se sentait attiré Pierre Million, noble poitevin, qui devint maître d'hôtel de Philippe le Long, comte de Poitiers, et qui mourut vers 1320. En 1320, Louis Emeric, seigneur de Rochefort, qui était alors en Bas-Poitou, payait aussi son tribut aux lettres. Il fut connu de Pétrarque, dont il reçut des éloges, comme étant l'un des meilleurs poètes de son temps. Vers la même époque, Guillaume de Montloudun, après avoir été gouverneur des enfants du roi de Hongrie, professait à Poitiers la philosophie et le- droit canon.
|
|
NOTES: (1) Nous ne voulons pas dire par lit que tout fut parfait, car sur certains points, notamment dans le Talmondais, se produisaient encore trop souvent des attaques a main année, et quelques ecclésiastiques séculiers ou réguliers, usurpant tous les droits réguliers ou privés, se faisaient trop souvent allouer à vil prix des biens très importants. Des meurtres trop souvent impunis, étaient aussi commis par des nobles et des roturiers ; mais il y avait néanmoins dans les moeurs un progrès indéniable.
|
|
ROBERT GIRARD, MOINE DE
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM
|
|
Sous Charles V, un moine de Saint-Michel-en-l'Herm, nommé Robert Girard, se rendit célèbre par ses observations astronomiques. Lors de la vente des livres provenant de l'abbaye, faite par le district de Fontenay, le précieux manuscrit qui avait échappé au sac de 1569, tomba- entre les mains de Gallot Jean-Gabriel (1). Ce fait étant venu à la connaissance de Lakanal, alors président du Comité d'instruction publique, le célèbre transformateur du Jardin du roi en muséum d'histoire-naturelle, écrivait à M. Poëy-d'Avant, alors receveur de l'enregistrement à Fontenay-le-Comte et, déjà apprécié par ses vastes connaissances en histoire naturelle, la missive suivante : Paris, le 24 mai 1793. " J'ai appris, citoyen, par le citoyen Garos, votre ami, que vous lui aviez autrefois parlé d'un manuscrit où sont des observations sur les saisons, le cours des astres, les phénomènes du .ciel et marées faites au temps de Charles V, par un moine de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm, nommé Robert Girard. Le citoyen Garos m'a dit que le manuscrit était présentement dans la bibliothèque du citoyen Gallot, qui a été à la Constituante. Il peut y avoir intérêt pour la science à ce que les observations (le ce moine soient vues par un astronome. C'est pourquoi je vous invite, citoyen, à faire l'es démarches nécessaires pour que le volume qui les contient me soit envoyé, par une occasion sûre, dans le plus bref délai. S'il est nécessaire d'en prendre la copie, il sera transcrit aux frais (le la commission et ensuite remis au. citoyen Garos, qui se chargera de vous le remettre en mains propres. « Salut et fraternité. Les événements malheureux qui survinrent à cette époque, a Fontenay, la prise de cette ville par les Vendéens, les graves désordres qui s'y accomplirent, ne permirent sans doute pas à Poëy-d'Avant de donner suite au desideratum de son correspondant, et l'affaire en resta sans doute là. Peu de temps après, Gallot abandonnait Fontenay, et se retirait à la Rochelle pour y exercer les fonctions de médecin militaire près l'armée de l'Ouest, dans lesquelles il se croyait plus utile (2).
|
|
NOTES: (1) Gallot, Jean-Gabriel, médecin distingué, né à Saint-Maurice-le-Girard (Vendée), le 30 septembre 1744, successivement membre de l'Assemblée provinciale du Poitou, député du Tiers aux États généraux, membre de l'administration départementale de a Vendée, mort le 4 juin 1791, d'un typhus d'hôpital qu'il avait contracté en-soignant les soldats malades. (2) Société d'émulation de la Vendée (année 1889). Jean Poëy-d'Avant et son cabinet d'antiquités, par A. Billon.
|
|
PIERRE DE BRESSUIRE
|
|
Pierre de Bressuire. dit Berchorius, surnommé le Pline du moyen âge, naquit à Saint-Pierre-du-Chemin, en 1292, d'une famille- de petits propriétaires, dont le nom a disparu vers 1450, et mourut à Paris en 1362. -Théologien remarquable, éloquent prédicateur, écrivain de talent, il fut, vers 1320, attaché au cardinal Després, vice-chancelier du pape.--R Honoré de la confiance de plusieurs papes, il fit à Avignon la connaissance de Pétrarque et, en 1350, il devenait l'un des secrétaires du roi Jean le Bon, à la prière duquel il traduisit en français l'Histoire romaine de Tite-Live, qui obtint un immense succès. - Vers 1351, il se fit bénédictin et composa une sorte d'encyclopédie intitulée Reductorium, repertorium et dictionarium morale ustriusque et testamenti, etc., imprimé pour la première fois à Strasbourg en 1474 (1). Dans cette encyclopédie (XIVe livre), il consacre un long article aux raretés du Poitou, notamment " à une, espèce d'oiseaux qui n'ont d'autre principe de production que la pourriture des vieilles planches des vaisseaux ", et à d'autres qui tous les ans envoient à la tour de Maillezais trois ou quatre députés pour examiner l'état des lieux avant d'y venir faire leurs nids. A côté de ces théories qui, aujourd'hui, nous feraient sourire, il n'en a pas moins écrit des choses remarquables, où il se révèle tout à la fois théologien, physicien, médecin-anatomiste, botaniste, géographe, astronome, etc. Le savant bénédictin fut inhumé à Paris dans la chapelle du couvent des Barnabites, dont il était prieur. Son corps fut déposé près de l'autel, du côté de l'épître et sous une tombe plate qui a disparu. Le Maire, dans l'ouvrage intitulé :.Paris ancien et nouveau, T. ;, page 375, donne son épitaphe, trop longue pour que nous la reproduisions ici. Marchebrusc, originaire du Poitou, et sa mère, au génie élevé et délicat, lauréate universelle des jeux floraux et , aussi des cours d'amour qui n'avaient pas encore complètement disparu, allaient habiter le pays de Mireille. Pierre Hugon, gentilhomme de Dompierre-sur-Boutonne, composait plusieurs chansons en l'honneur de Béatrix d' Agout, sa danse, qui présidait la cour d'amour. il mourut vers l'an 1321. Un travail semblable se produisait dans les sciences physiques, l'anatomie, la botanique, la théologie, la géographie, etc., et on peut dire que celui qui posséda au plus haut degré toutes ces connaissances réunies, fut le bas-poitevin Berchorius, cité plus haut.
|
|
NOTES: (1) Une traduction française (le son Histoire romaine de Tite-Live fui, éditée à Paris, 1511-1515, 3 volumes in-Folio. - C'est le roi Jean qui lui avait donné l'ordre d'écrire cette traduction. - On a sa signature apposée en qualité de secrétaire de ce prince, au bas de lettres royales délivrées le 21 août 1353, en faveur de l'église de Pontoise.
|
|
29 OCTOBRE 1324 SPÉCIMEN DE LA LANGUE ET DE L'ORTHOGRAPHE FRANÇAISES EN BAS-POITOU AU COMMENCEMENT DU XIVe SIÈCLE
|
|
L'acte (1) original en parchemin. dont nous publions le texte, est conservé dans les archives de la Vendée, parmi les titres du, prieuré de Fontaines, situé en la paroisse du Bernard et dépendant de l'abbaye de Marmoutier. La transaction qu'il contient est peu importante, ainsi que le fait remarquer le savant M. Marchegay, à qui nous empruntons ces renseignements, mais elle présente un intérêt réel comme spécimen de la langue française et surtout de son orthographe, remarquables par leur analogie avec celles de nos paysans d'aujourd'hui. Elles paraîtront d'autant plus incorrectes que ceux qui ont rédigé ou dicté notre acte sont, d'une part, le véritable souverain de la contrée, le vicomte de Thouars, prince de Talmont; et de l'autre, le procureur ou fondé de pouvoirs d'un abbé d'un des monastères les plus renommés et les plus riches de France, celui de Marmoutier, près Tours, dont nous avons déjà parlé.
|
|
NOTES: (1) "C'est le traitié e l'acort fait entre noble home mon seygnour le viconte de Thoars e frère Richart Le Barber, moyne de Mermoster, procurour de religiouz homez l'abbé e couvent de Mermoster. Premerement ge le dit procurour aprove et ratefié le traitié qui fut fait à Longeville entre religiouz home e honeste l'abbé de Saint Jehan d'Orbester, d'une part, se portent por ledit noble, e frère Jofrey Oboin, priouz de la Roche, se portens por religiouz homez l'abbé e le couvent de Mermoster, e frère Guillaume de La Corbère, priour de Fonteynnes, de l'autre ; qui tele est : Premerement ge le dit procurour, tant comme procureur voit que les amonicions e les procès de l'église fait por ledit abbé e couvent contre ledit noble, de l'auctorité au chantre do Sauveour de Bleys, sous délégat et commissaire de religions, home et honeste l'abbé de la Trinité de Vendome, juge e conservateur des privilèges à l'abbé au convent de Marmoster davant diz, sunt por nun faiz ; e ge le dit procureur, les anichille e revoque du tot, e voit que il séant de nul efeit en lot temps. E noz Johan, viconte de Thoars davant dit volons et consentons que tos les fays et les esplez qui hont esté faiz en prieuré de Fonteynnez e eus apartenencez des deux enssa, por nez ou por autre en nom de noz. séant houz por non faiz en toz temps ; e une jument e autres prisez, s'eles y sont, ferons restituer e restablir e est pris j'ors entre les parties, c'est assaveir lendemagne de la Saint Johan Batiste prochain, à Longeville, auquel jor noz ledit viconte serons. . E ge le dit procureur promet a fayre e porchacier o efeit que frère Guillaume de La Cerbère, priour de Fonteynnes, y ,sera suffisamment fondé pour trayter e reostrerra audit noble e a son conseil les originaux de lors franchicez e de lors libertez, e noz ledit vicomte nos raisons ; e si noz poor acorder bien est, sinon a chascun demoret son drey sauve, sens innover ne diminuer, excepté les chozes desus ancanteez qui demeurent à toz jors mès de nul efeit; e dedens le jour do traytié l'uns n'atemptera riens contre l'autre. En tesmoiny de la cete choze, nos vicomte davant diz trayons mis en cete presente letre nostre propre seya. Fait le lindi avant la feste de Tes Sains, l'an de grâce mil troys cens e vingt e quatre." Recherches historiques, par Paul Marchegay, Un
document par canton, 1867.
|
|
MODE DE SUCCESSION NOBLE
EXISTANT ENTRE LA DIVE ET LA SÈVRE ET ENTRE LA SÈVRE ET LA MER.
|
|
Dans la portion du Poitou comprise entre la Dive et la mer, la transmission des fiefs a été jusqu'au commencement du XVIe siècle, régie par une loi toute particulière appelée Retour. Ils n'y passaient pas du père au fils aîné, mais successivement, et suivant leur ordre de naissance à chacun des frères puînés du défunt. Par le décès du dernier d'entre eux seulement, le fils aîné de. l'aîné réunissait l'usufruit à la nu-propriété sur laquelle ses oncles n'avaient aucun droit. Cette loi atténuait la rigueur du droit d'aînesse; mais le nombre des abus, procès et troubles qu'elle engendra, fit solliciter et obtenir son abolition par les trois États du Poitou. A l'appui de cette thèse, le savant M Marchegay a donné dans l'Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée (1867), deux documents fort intéressants et on ne peut plus affirmatifs. L'un provient des archives de Salidieu, près Mareuil, et porte la date du 12 février 1496 (1). L'autre, plus ancien, concerne surtout le canton de Chantonnay. Il porte la date du 23 juillet 1278 et a pour titre : La part héréditaire d'un cadet de la maison de Thouars. C'est en vertu de cette coutume, consignée dans le premier document que nous venons de relater plus haut, et rendant les généalogies des barons poitevins très difficiles à dresser, que Savari, troisième' fils de Gui, vicomte de Thouars et d'Alix de Mauléon, posséda après la mort de ses deux frères, Aimeri et Rainaud, les, vastes domaines de son père et de sa mère.. Savari ayant cessé de vivre vers la fin de l'année 1274, Gui, fils d'Aimeri, devint vicomté de Thouars, dont ses héritiers directs continuèrent à jouir conformément au droit de retour, -nom donné au mode de succession que nous venons d'indiquer. Quoique déjà marié avec Marguerite d'Eu, et sinon majeur, du moins émancipé, Aimeri est assisté, dans; la pièce qui; suit; de sa mère Marguerite de Lusignan et de Geoffroi de Châteaubriant, son second époux, parce que celle-ci possédait à titre de douaire, quelques-uns des domaines dont dispose notre charte. Elle concerne en effet un échange passé entre le jeune vicomte et Agnès de Pons, veuve de son oncle Savari, au sujet de l'oscle ou douaire de cette dame et de la portion héréditaire de sa fille unique, Alix. La part d'Agnès et celle d'Alix, fixées; par un acte du 30 décembre 1274, furent modifiées le 25 juillet 1278. Au lieu de leur tiers dans les seigneuries de Pouzauges, du Boupère; de la Morvien, de Monsireigne, de Chavagnes-en-Pareds, de la Fenêtre, de Sigournais, de 1'lle-de-Bouin, de Soullans, du MaraisCoutumier et de l'Ile-d'Yeu, les deux dames reçurent dans leur entier les seigneuries du Puybéliard, de Chantonnay, de Château-Guibert, de Mareuil et de l'Herbergement-Ydreau. La charte, rédigée en langue vulgaire, est des plus intéressautes pour l'histoire du Bas-Poitou. Elle donne en effet des détails sur plusieurs localités pour lesquelles les documents sont très rares, entr'autres sur Chantonnay et sur les principaux domaines et vassaux de ce fief, érigé plus tard en baronnie. Notre chef-lieu de canton est appelé ici Chantaonnois. Pendant les quatre ,siècles qui suivirent, il fut nommé Champtaonnat; Chantaunay, et surtout Chantagnès, en latin Cantus Agnetis. L'orthographe actuelle ne paraît qu'à partir de l'année 1600. Le texte de la charte, que nous avons abrégé en supprimant des formules inutiles et divers passages peu importants, a été découvert dans le chartrier de Thouars. Il est inséré dans l'acte par lequel la jeune Alix, fille de Savari et d'Agnès, confirme, en juillet 1287, les deux traités faits en 1271 et 1278 par sa mère et tutrice avec son cousin le vicomte Gui. Possédés au XIVe siècle, par la puissante maison de Craon, Chantonnay, le Puybéliard et Mareuil entrèrent par mariage, dans la maison de la `Trémoille. Louis II, le chevalier Sans-Reproche, qui devint vicomte de Thouars, du chef, de sa mère Marguerite d'Amboise, ayant acheté 'la baronnie de Montaigu à Jean de Belleville, seigneur de Sigournay, lui céda en 1519, les seigneuries de Chantonnay et du Puybéliard, estimées 20.000 livres, pour compléter le paiement des 80.000 livres, prix de son acquisition.
|
|
NOTES: (1) "A touz ceus qui verront et orront cestes presentes lettres, nous Gui, vicomte de Toarz, chevalier, sise en celi tens de Toarz et de Talemont, et nous Geufray, sire de Chastiau Bruiant, chevalier, et nous Marguerite du Lezeignen, sa fame, dame de la Chiese et mers audit viconte, de, Toarz, et nous Agnès de Ponz, dame de Maroil, fame ça en arrière à noble home Savari, jadis viconte de Toarz, salu en Nostre Seignor durable. Sachent tuit qui sont et quia venir sont que nous ledit vicomte de Toarz, o la volenté et o l'assentemet dondit Chastiau Bruiant et de ladite noble dame Marguerite de Leseignen, sa fame et nostre chere mere, d'une part, et nous ladite Agnès de Pons, de l'autre part, de noz bonnes volentez et non déceu, avon fet et feson permutation et perpétuel eschange de nos choses.. en tel manière que nous ledit vicomte de Toarz... avon baillé, livré, et octroié... à la dite noble dame Agnès de Ponz et a Aaliz sa fille, et fille audit Savari, jadis viconte de Toarz, notre Oncle, notre chastiau et nostre chastelerie dou Pui Béliart et toute la vile doudit Pui Béliart, o toutes ses appartenances, et nostre ville de Chantaonnais, o le manoir qui i est et toutes ses autres apartenances, et nostre ville de nostre manoir de Chastiau Guibert o toutes ses appartenances, et tout ce que nous avons et avoir poon et duon... esdites ville dou Pui Béliare, de Chantaonnais et de Chastiau Guibert, et en toutes les appartenances desdiz leus, c'est à savoir: domaines, manoirs, villes, rentes, cens, taillées, bianz, destroiz, prez, bois, chaufages usages, garenes, fours, molins, peschages, haute, justice et basse, servanties, fiez, rerefiez ; et touz les homages plainz et liges. C'est à savoir par reson dou Pui Béliart :' l'omage des bers feu Pierre Loiau, o ses apartenances et les homages de Jehan Prevoust de la Touche Embert, de Symon de l'Angle, de Aimeri Bruiant, sire de Digne Chien, des hers feu Renaut Levesque, de la dame des Bochaus, de Johan de la Barbrère... Et par raison de Chantaonnais l'omage dou seigneur de Saint-Marz, et les homages dou seigneur de la Tabarière et de Crous... Et par reson de Chastiau Guibert, l'omage dou prévoust de Chastiau Guibert.. et touz et chacun les autres hommages plains et liges, appartenanz ausdiz leus, et tout ce généraument sanz riens i retenir.. . A avoir toutes les choses desusdites et chacunes à tenir, a espleter dès orendroit a perpetuauté... pesiblement,, franchement et quittement de ladite Agnès, por raison de doaire, de oscle ou de domaison por noces, tout son viage ; et après sa mort, de ladite Aaliz sa fille, comme héritere et des hers descendanz de sa char, ou des hers qui des hers de sa char descendront perpétuaument, segont costume de païs ; ensembleement o le chastiau de Maroil et o le, chastiau de l'Abergement Ydereau, o toutes lors aparte - nances... Et ce fet nous lidiz vicomte de Toarz, avon fet et feson o la volonté et o l'assentement de madame Marguerite d'Eu, nostre fame... Et nous ladite Agnès de Ponz feson a savoir à touz, que nous avion lessié, quité et octroie, pour nous et pour ladite Aaliz, nostre fille, en perpetual permutacion et en perpétuai eschange audit noble, monsieur Gui, vicomte de Toarz, la tierce partie que nos avion et esploition et avoir poion et devion à Pozauges (2), à Aube Pore... et en manoir de la Mort Vivien. et a Monsireigne et a Chaveignes et a la Fenestre et a Ségornay et en l'ille de Boig et en Solanz et en Mareis Costumer et en toutes les appartenances, et la tierce partie que nous avon en ce que ma dame d'Ardene, fahue, soloit avoir en Oys : a avoir, a tenir et a esploitier des orendroit a perpetualté... doudit viconte de Toarz ou de ses hors ou de ses successors, por renon de l'eschange des choses que il a baillé a nous et a ladite Aaliz, nostre fille, si comme desus est dit... Et prometon et graaton, nous Agnès de susdite, que nous feron et procureron vers ladite Aaliz nostre fille, de denz l'aage de quatorze anz accompliz, c'est à savoir entre l'aage de doze anz et quatorze anz accompliz, que elle voudra et ratifiera cest fet et la teneur de ceste letre, et que elle le jurra a tenir et a garder a tout ers més, ranz venir encontre à Toarz, audit vicomte à ses hors ou a son commandement... Et ce nous prometon et graafon par nous fere et acomplir, sur l'obligation de touz noz biens moebles et nou moebles, presenz et avenir... et quant à la ratificacion qui se doit fere par nostre fille, a peine de mil et tint cenz livres de monoie corant, les quex nous serions tenue à rendre audit viconte ou, aus suens se ladite Aaliz, notre fille, ne voloit retefier, c'est nostre fet de denz le tems desus dit. Et que ce soit ferme et eslable a toz jorz més, nous dit vicomte et nous Geufrai et nous Agnès de Ponz, desusdiz en cestes présentes letres aposames noz séaus, en tesmoing de vérité et en perpétuai mémoire des choses desusdites, ensembleement o le séel de la séneschaucie de Poitou establi a la Roche-sur-Yon pour nostre seigneur le roi de France... Ce fu fet, et cestes letres douées, ou jour de lundi après la feste de la Madelene, en l'an de l'Incarnation Nostre Seignor Jhesu Crist, mil deus cenz sexante et dix et oit, ou mois de juignet." Annuaire 1867, pages 246.249.
(2) Pendant qu'elle possédait Pouzauges, Agnès y avait donné à Denise, sa nourrice, a tierce partie d'une maison qui lui fut garantie par notre charte.
|
|
CANTON DES ESSARTS, Etc. LE MARIAGE DE LA FILLE AINEE DU SEIGNEUR EN 1340
|
|
La loi féodale autorisait le suzerain à lever doubles cens et taille sur ses vassaux et sujets dans cinq circonstances : 1° et 2° quand lui et son fils aîné étaient armés chevaliers ; 3° quand il mariait sa fille aînée; 4° afin de payer sa rançon s'il était pris à la guerre, et 5° pour contribuer au paiement des fiefs qu'il pourrait. acheter. Quelquefois les vassaux obtenaient par charte expresse, l'abolition de cet impôt ; et nous en avons un exemple pour la Mothe-Achard. Saint-Hilaire-le-Vouhis et Falleron,, dans la 70e' charte du cartulaire des sires de Rays. En général, cette libération était facilement accordée aux gens d'église:; par les lettres mêmes qui leur confirmaient et amortissaient sur immeuble, une rente en un simple droit acquis à titre gratuit, ou même onéreux dans l'étendue d'un fief laïque. Savary III de Vivonne ne voulut pas renoncer à ce double impôt en faveur de l'abbaye , d'Orbestier. Pour ce que son monastère possédait dans une lointaine, dépendance de la baronnie des Essarts, l'abbé dut venir des bords de la mer jusqu'au milieu, du Bocage, compter au châtelain Robert Rennoul, la somme imposée sur son domaine de Vairé, près la MotheAchard, à l' occasion du mariage de Mlle Vivonne, l'aînée. Les 400 sous qu'il paya représentent environ 300 francs de notre monnaie. L'arrière petit-fils du baron des Essarts,, Savary V du nom, fut un vaillant chevalier. Il combattit les Infidèles et tomba, entre leurs mains à la funeste bataille de Nicopolis, en l'année 1396 (1), mais ses vassaux poitevins n'eurent pas de rançon à payer, parce que les Turcs massacrèrent impitoyablement 1 a, plupart de leurs prisonniers, M. de Vivonne, entre autres. (Annuaire de la Société d'émulation, 1858, page 226, Marchegay.)
|
|
COMMERCE. - INDUSTRIE.
ÉTAT SOCIAL A FONTENAY AU COMMENCEMENT DU XIVe SIÈCLE.
|
|
Deux industries, celles des draperies et des cuirs, qui s'exerçaient depuis plusieurs siècles à Fontenay, prirent, à cette époque, un développement considérable, et contribuèrent à lui faire occuper un des premiers rangs parmi les villes de la province. Sa bourgeoisie, devenue riche, reçut une sorte d'orga-nisation municipale. Elle eut son conseil de prud'hommes, sous la présidence du prévôt. Bientôt elle se trouva en mesure de tenir le haut, bout, dans la circonscription territoriale qui l'entourait, et les seigneurs des fiefs compris dans l'enceinte fortifiée, furent obligés de lui abandonner le soin de pourvoir elle-même à sa sûreté. C'était enlever à la féodalité le pouvoir de lui nuire. Les simples palissades qui reliaient les cinq portes, les défenses des Mottes-de-la-Vau, du Château-Gaillard et de la Grosse-Tour furent remplacées, aux frais des habitants de la ville, par des fortifications solidement bâties, dont des parties subsistent encore sur la rive gauche de la Vendée (1). Le capitaine du château, nommé par le Roi, eut de la sorte sous ses ordres une milice capable, sans qu'il fut besoin d'aucune autre aide, de résister à un coup de main. Les bourgeois fontenaisiens ne s'en tinrent pas à' cette première conquête. Quels moyens employèrent quelques-uns d'entre eux pour acquérir des biens nobles ? On l'ignore. Toujours est-il qu'en 1335, Guillaume Bouin, Guillaume Goupil et Régnaud Morissonneau, le premier drapier; les autres tanneurs, en possédaient autour de la ville. Bouin paraît même avoir été anobli. L'aristocratie vit ces empiétements d'un mauvais oeil mais ils finirent cependant par passer à l'état de faits accomplis, puisque le fils de Bouin épousa, en 1341, une Goulard, demoiselle de race chevaleresque, et qu'il y eut ensuite plusieurs autres alliances entre les familles nobles et celles de ces roturiers enrichis (2).
|
|
NOTES: (1) On a trouvé, en démolissant une partie de a muraille de cette époque, qui défendait a ville du côté de la rivière, un petit dépôt d'une vingtaine de pièces de Philippe-le-Long et de Charles-le-Bel, parmi lesquelles était ce rare denier de Robert d'Artois, frappé te Mehun-sur-Yèvre, avec légendes françaises. (2) Fillon. - Histoire de Fontenay, pages 30 et 31.
|
|
ÉTAT SOCIAL GÉNÉRAL
EN BAS-POITOU. - LES ROTURIERS EUX AUSSI PEUVENT ACQUÉRIR.
|
|
Si maintenant nous résumons. l'étude que nous venons de faire, nous voyons en Bas-Poitou, dès les premiers temps de la féodalité, trois classes d'hommes vivant sur le même sol, et régis par trois gouvernements différents : les nobles par le gouvernement féodal, les clercs par le gouvernement ecclésiastique, les serfs par le gouvernement domanial. Les nobles, hauts et puissants justiciers, tels que les Chabot, les Chasteigner, les vicomtes de Thouars et princes de Talmont, les de Châteaubriant, etc., ne connaissent en fait de devoirs que ceux du vassal envers le suzerain à part l'hommage, ils ne relèvent guère que de leur conscience. Les ordres religieux jouissant d'un crédit illimité, possèdent des terres d'Église. Ces terres constituent une masse compacte, un territoire assez arrondi, bien que les communautés aient des dépendances dispersées un peu partout. Le peuple compte dans son sein des vilains francs, descendants des colons de l'époque romaine, qui avaient réussi à garder leur demi-liberté, et dont les fils arriveront plus tard aux premières charges de la cité, après s'être enrichis par le commerce, tels que les Yver et les Regnaud. Les premiers sont liés par un contrat, les seconds par les canons de l'Église ou leur règle monastique, les troisièmes par la volonté d'un maître. Mais au-dessus de ces trois classes, et les dominant par son principe, se place la royauté. Bien que, le prince soit souvent moins puissant que ses grands vassaux, il a, pour lui le souvenir de l'idée romaine, de la monarchie qui subsiste chez les clercs, le souvenir de l'Empire chez les vilains, par le besoin d'un protecteur naturel qui puisse mettre un frein aux guerres civiles et à la violence des seigneurs, aussi peu humains quelquefois que le terrible Geoffroy la Grand'Dent. La royauté n'ignore pas ces aspirations opposées à la toute puissance des grands, divisés d'intérêts et souvent sans esprit national ; elle saura entretenir fort adroitement ces rivalités pour le triomphe de sa politique, et le temps n'est pas éloigné où nous verrons en Bas-Poitou les plus illustres magistrats du roi pris dans ce tiers-état, si effacé d'abord, mais chez lequel, se développe et grandit avec le sentiment de sa valeur et de ses droits, son amour passionné et réfléchi de la liberté. A l'exemple de la bourgeoisie, les serfs vont eux aussi devenir propriétaires de biens seigneuriaux, et c'est ainsi que le 12 décembre 1416,. Miles II, vicomte de Thouars, seigneur de Pouzauges, baille à rente perpétuelle, moyennant 15 sous, à Georges Achard, boucher à Pouzauges, des maisons, masureaux et vergers " sis près la quéruelle de l'église de Saint-Jacques, le grand chemin entre deux, par lequel l'on voit de la cohue dudit Pouzauges à la chapellenie dudit lieu ". (Marchegay, - Recherches sur les seigneurs de Tiffauges.)
|

|

|
| Chapitre Précédent | Table des matières | Chapitre Suivant |