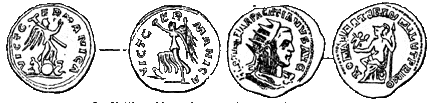|

|
|
Histoire de la Vendée du Bas Poitou en France |
||
|
|
||
| Chapitre Précédent | Table des matières | Chapitre Suivant |
|
|
|
Trente ans avant Jésus-Christ, l'agriculture était prospère, et la récolte du blé assez abondante dans notre pays pour permettre des exportations au midi de la Gaule. Dans ses " Commentaires " Jules-César, l'historien-conquérant que nous allons voir venir, l'épée dans une main et la plume dans l'autre, apportant une lumière impérissable à notre histoire, et une servitude passagère à nos aïeux, dit que les Helvètes fuyaient leur pays qui ne pouvait les nourrir, pour aller s'établir dans celui des Pictons et des Santons qui possédaient du blé en abondance. Dans un fort savant Mémoire paru dans le Bulletin agricole d'octobre 1888, M. Levrier, ancien avocat à Niort, donne d'intéressants renseignements sur la moissonneuse qu'avaient inventée nos pères et qu'a décrite Palladius (1). Tout le centre de la Gaule jusqu'à Limoges et Bourges venait s'approvisionner de sel dans la région qui constitue aujourd'hui une partie de l'arrondissement des Sables-d'Olonne, et le chemin des Sauniers venant de Poitiers par Charzais, dont le nom a survécu à bien des Révolutions, était au commencement de l'ère chrétienne, avec le Chemin- Vert, dont nous parlons plus loin, la grande route commerciale conduisant aux côtes de l'Océan.
Un pays aussi riche que le Bas-Poitou, placé non loin de l'embouchure- d'un grand fleuve, sur les bords de l'Océan, ne devait pas échapper à la convoitise romaine. Depuis le jour où le brenn des Gaulois pesant la rançon de Rome avait jeté son épée dans la balance en disant: " Vœ victis l. Malheur aux vaincus ! " les Romains avaient résolu l'asservissement de toute la Gaule. Ils commencèrent d'abord par la Cisalpine, qu'ils emprisonnèrent dans un cercle de forteresses... Puis vint le tour de l'Armorique et du Bas-Poitou. Ces dernières proies étaient réservées à Jules-César. " J'aurais voulu voir, dit Michelet, cette blanche et pâle figure, fanée avant l'âge parles débauches de Rome, cet homme délicat et nerveux, le front nu sous les pluies, de la Gaule, à la tête des légions, traversant nos fleuves à la nage ou bien à cheval, au milieu de sa garde germaine, entre les litières où ses secrétaires étaient portés, dictant quatre, six lettres à la fois, exterminant sur son chemin deux millions d'hommes, et domptant en dix années, la Gaule, le Rhin et l'Océan du Nord ". Vainqueur des Venètes et maître de Nantes, l'antique Condivincum, Jules-César vient mettre le siège devant Durinum, aujourd'hui Saint-Georges-de-Montaigu. Après une lutte désespérée il entre en triomphateur dans la vieille cité gauloise, placée dans une position stratégique admirable, au confluent des Deux-Maines. Là il s'y retranche, et aussi habile politique que grand général, il essaie de faire des vaincus de la veille, des alliés pour la grande lutte qu'il prépare contre Pompée. Des plus vaillants soldats de ce pays honoré par lui du nom de mata gens, il forme une légion à laquelle il donne; pour enseigne l'alouette, symbole de la vigilance et de la gaieté. Consolée de la servitude par la gloire, cette brave légion, où dominent les Pictons, passe les Alpes, en chantant, harcèle jusqu'à Pharsale les soldats de Pompée, entre -victorieuse à Rome, comme autrefois avec le breun, et met à ses pieds l'empire du monde. Cinquante ans après la conquête, sous l'empereur Auguste, les Romains emploient pour le Poitou la politique habile qu'ils appliquaient partout.- Les Pictons sont séparés dé la grande famille celtique où le vieil esprit n'était pas encore éteint. Réunis à l'Aquitaine, ils devaient peu à peu subir l'influence de cette portion de la Gaule promptement devenue une province romaine (2). |
|
NOTES: (1) Palladius, fils d'Exupérance, préfet des Gaules, naquit à Poitiers durant le Ve siècle. Nous lui devons un Traité d'Agriculture en quatorze livres. (Thibaudeau, Histoire du Poitou). (2) D'après le Père Arcère, Tibulle aurait accompagné en Poitou le- général romain Messala.
|
|
|
VOIES ROMAINES PRINCIPALES
ET MANSIONS
|
|
Quelque amers que pussent être les regrets du passé et le souvenir de la vieille liberté gauloise, l'admnistration des empereurs et des proconsuls sut les effacer par sa modération, son impartialité et sa préoccupation continuelle des intérêts généraux. A côté des camps retranchés de Pouzauges, de Saint-Michel-Mont-Mercure, de Tiffauges, de Mortagne, etc., où Agrippa établit, selon les circonstances, son quartier général, des voies romaines dont le tracé, certain pour quelques-unes, l'est aussi à peu près pour d'autres, en raison de considérations que nous ne pouvons développer ici, sillonnent le pays et assurent les communications entre Nantes, Angers, Poitiers, Limoges, Bourges, Saintes et-les côtes de l'Océan. 1. - De Nantes â Rom, par Montaigu, Saint-Georges-de-Montaigu{Durinum), Bazoges-en-Paillers, Le Plessis-de-Beaurepaire, Le Plessis-des-Herbiers, La tonnelle, Les Herbiers (Ardelay près), Bois-Jolly, La Blinière, Pouzauges, Montournais, Saint-Pierre-du-Chemin et L'Absie (1). 2. - De Nantes à Saint-Gilles, par Port-Saint-Père, Machecoul, Varnes, Challans, Riez (2). 3. - De Nantes à l'Absie, par Vertou, Le Pallet, Tiffauges, La Verrie (près), Le Châtellier, Menomblet, Saint-Pierre-du-Chemin (3). 4. - De Nantes à Saintes (2 tracés). Le 1er par Montaigu, Saint-Georges-de-Montaigu, Les Quatre-chemins-de-l'Oie. L'Herbergement-Ydreau, Le Plessis, Saint-Vincent-fort-du-Lay, Ingrandes (4) près La Réorthe, Champgillon, Thiré (l'antique Ruson), Féolette, Le Langon,, Velluire. Reth, Le Vanneau et Sansais, où elle rejoint la ligne d'Angers â Saintes (5), par Usseau et Torxay (6). 5. - De Nantes à Saintes (2e tracé). Par Saint-Georges-de-Montaigu, Benaston, La Rabatelière, Les Essarts, le Moulin-des-Loges, La Lévinière, Puymaufrais, Sainte-Hermine, Mouzeuil, Le Langon, etc. (7). 6. - De Nantes à Beauvoir, par Rezé, Les Sorinières, Viais, Saint-Philbertde-Grand-Lieu (Déas), Bois-de-Céné (près) (8). 7. - De Nantes ci fard, par Viais, Saint-Philbert, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Froidfond, Saint-Christophe-du-Ligneron, Apremont, La Mothe-Achard, Grosbreuil (près) (9) .
8. De Nantes à Jard, par Viais, Saint-Colombin, Légé, Saint-Etiennedu-Bois, La Chapelle-Palluau, Aizenay (près), La Chapelle-Achard, Grosbreuil (10). 9. - De Nantes à Mareuil, par Saint-Georges-de-Montaigu, Les QuatreChemins-de-Grala, La Merlatière, Thorigny, Mareuil (11). 10. - De Saintes à Beauvoir, par Sansais, Le Vanneau, Reth, Velluire, Le Langon, Nalliers (près), le Pont-de-Silly, Mareuil, La Routière (Aubigny), Apremont, Challans (près), Saint-Gervais, Beauvoir (12). 11. - De Bourges à Saint-Gilles, par Ension (Saint-Jouin-de-Marne), La Pommeray-sur-Sèvre, Les Châtelliers (près), L'Herbergement-Ydreau, Les Essarts, La Merlatière, Aizenay (près), Apremont (13). 12. - D'Angers à Saint-Gilles, par Cugand, La Pénissière, Durinum, L'Herbergement, Les Lues, La Chapelle-Palluau (près), Maché (près), Apremont (14). 13. - De Bourges aux Sables-d'Olonne, par Ingrande, l'Absie, La Loge-Fongereuse, Sainte-Hermine, Mareuil-sur-le-Lay, Saint-Avaugour-des-Landes, Le Poiroux (près), Château-d'Olonne (15). 14. - De Bourges à Beauvoir, par Voultegon (Segora), Châtillon, La Louvrenière de Saint-Martin-Lars-en-Tiffauges, où on a trouvé une borne milliaire, Durinum, Saint-André-Treize-Voies, Rocheservière (près), Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Varnes, Châteauneuf, Beauvoir (16). 15. De Poitiers à la Gachére, par Allonne, rie Busseau, Puymaufrais, où il existe des restes de l'ancien pont romain appelé le Grand-Pont déjà cité, Trizay (fours â potiers gallo-romains, restes d'habitations, trouvés vers 1860),Saint-Florent-des-Bois (près), La Chapelle-Achard, Vairé (près) (17). Le long de ces grandes voies, comme à Saint-Georges-deMontaigu, Cugand et probablement Mareuil, Fontenay-le-Comte, Le Langon, Apremont, l'Herbergement-Ydreau, se dressaient des mansions : c'étaient des sortes d'hôtelleries, des lieux de repos plus particulièrement destinés à servir d'étapes aux corps de troupes en mouvement, mais où les simples voyageurs trouvaient aussi des bâtiments pour se reposer et prendre la nourriture (18). De mille en mille pas romains (environ 1181 m. 50), s'élevaient, sur les routes, des bornes milliaires marquant les distances. Plus hautes que les nôtres, elles formaient, soit des colonnes, soit des petits monuments, sur lesquels on gravait souvent des inscriptions. - Vers 1832, on a trouvé, à Saint-Pierre-du-Chemin, une de ces bornes milliaires, déposée au musée de Nantes, croyons-nous, et plus récemment encore, une autre à la Louvrenière de Saint-Martin-Lars-en-Tiffauges. |
|
NOTES: (1) Cette voie, que nous avons retrouvée sur
plus de 12 kilomètres, lie passe point IX. Beaurepaire, comme
l'ont prétendu divers auteurs : elle se rend de Bazoges aux
Herbiers, par Les Plessis et La Tonnelle. acute; certain jusqu'à Machecoul, d'après le Bulletin de la Société de géographie de Nantes, année 1898 (Léon Maître), probable pour les autres points. (3) Mentionnée de Nantes à Tiffauges, bulletin déjà cité. (4) Le non d'lngrandes indique ordinairement non seulement une frontière, mais l'endroit où un chemin, soit gaulois, soit, romain, passait du territoire d'un peuple dans celui d'un autre. (5) Certains autours prétendent, qu'à partir du Langon, elle se dirigerait sur Saintes, parle Gué-de-Velluire, Saint-Jean-de-Liversay, Le Gué d'Allère et Surgères. (6) Voie reconnue par nous du Langon à Reth, signalée de Sansais à Saintes, par M. Lièvre. - Le reste, connu du Plessis à La Réorthe.-Probable pour le reste. (7) A Puymaufrais, existent sur le Lay les restes d'un pont romain, que nous avons vu il y a de longues années. Il est connu dans le pays, sous la dénomination de Grand-Pont. - Tracè connu sur plusieurs points, probable sur d'autres. (8) Société de géographie de Nantes (année 1898). Léon Maitre. (9) Tracé suivi, indiqué par M. Billon. (10) (L'abbé Baudry). (11) Tracé probable. (12) Tracé repéré' par nous, de Reth à Sansais. - Restes du vieux pont romain à Mareuil, vestiges nombreux de l'époque gallo-romaine partout. - Voie d'emprunt. (13) Tracé très probable. (14) Tracé connu de la Sèvre aux Lues : probable plus loin. (15) Retranchements gallo-romains entre le Poiroux
et Saint-Avaugour. (16) Tracé certain sur quelques points, probable sur d'autres. (17) Tracé probable. (18) Anthony Rich. - Dictionnaire des Antiquités grecques et latines.
|
| VOIES ROMAINES SECONDAIRES |
A ces voies principales s'en rattachaient des secondaires en très grand nombre, parmi lesquelles nous citerons seulement : 1° Une voie romaine ou gauloise améliorée, allant des Lues à Saint-Gilles, par Palluau, Commequiers et le Pas-Opton (Fillon) ; - 2° une autre, de Mareuil â Talmont, par les Moutiers-les-Mauxfaits; - 3° une autre, de l'Absie à Sigournais, par Saint-Pierre-du-Chemin, Le Paligny (bois), et Bourdin (Aude et Richer) 4° celle de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu â l'Herbergement, par Saint-Colombin, Bouaine, Saint-André-Treize-Voies (Léon Maître. Bulletin de la Société de géographie de Nantes, année 1898) ; - 5° de Viais â l'Herbergement, par Geneston et Saint-André-Treize-Voies (Léon Maître) ; 6° une autre, appelée Grand-Chemin du Bocage, dont il reste des traces près la Touche de Sérigné, à la ferme du Grand-Chemin et près la Coudraye, se dirigeait probablement des Herbiers et de Chantonnay sur Fontenay. Cette dernière devait être sans doute un tronçon du chemin conduisant de Nantes à Fontenay et qui aurait facilité aux pirates le parcours du pays (1). On peut conclure par l'examen des cartes que si pour les voies stratégiques, les Romains n'ont point toujours tenu compte des routes tracées par les Gaulois, il n'en a pas toujours été de même quand il s'est agi de la communication d'un centre à l'autre, car il ne faut pas oublier que les Romains ont conservé les mêmes centres de populations que les Gaulois. Un fait digne de remarque, c'est l'analogie curieuse qui existe entre la direction des voies romaines et celle suivie par les routes nationales, et aussi par les lignes stratégiques dont on sillonna la Vendée, à partir de 4833. C'est ainsi, qu'à la Pénissière de la Bernardière, la voie romaine et la voie stratégique viennent se rencontrer. Il n'est donc pas téméraire d'affirmer que le territoire des Civitas Pictonum était couvert d'un véritable réseau de voies de toutes sortes, preuve indéniable d'un grand développement de civilisation et de prospérité. Aussi Larry était-il autorisé à dire dans ses considérations sur la géographie ancienne du Poitou, en ces temps où il ne pouvait encore prévoir le merveilleux développement des voies ferrées " ce luxe de communication qui a souvent excité notre admiration " que le Poitou jouissait à ces époques reculées des avantages d'une civilisation très avancée, et qui n'avait rien à envier à -la civilisation contemporaine si justement fière de ses progrès (2). |
|
NOTES: (1) Histoire du Poitou, par l'abbé Auber. T. v., p. 480. Recherches personnelles. (2) Mémoire de la Société de Statistique des Deux-Sèvres. T. XII (années 1847-48 et 49).
|
| LES DEUX PLUS ANCIENNES VOIES
COMMERCIALES GAULOISES DU BAS-POITOU LE CHEMIN-VERT. -LE CHEMIN DES SAUNIERS.
|
|
Les deux plus anciennes voies commerciales gauloises du Bas-Poitou, utilisées et améliorées par les Romains, sont sans nul doute le Chemin- Vert et le Chemin des Sauniers, dont les traces sont encore visibles sur un grand nombre de points de la Vendée, et dont la chaussée a été utilisée lors de la construction de plusieurs routes de notre département (1). Le Chemin-Vert, dont le nom a survécu à bien des révolutions, était à une époque fort éloignée, la grande voie de communication entre les régions situées au-delà de Niort et les côtes de l'Océan. Partant de Limoges, il passait par ou près Mougon, Niort, Benet, Lesson, Nieuil-sur-l'Autise (2), Xanton, Saint-Martin-de-Fraigneau, Darlay, et se réunissait à la barrière de Parthenay (Fontenay) avec le Chemin des Sauniers,, venant de Poitiers par Charzais. Confondues ensemble au point sus-indiqué, ces d'eux voies traversaient Fontenay-le-Comte, laissaient à gauche les Essarts, la Garnison, la Garde, passaient au-dessus Puy-Bernier, pour de là se rendre-à Petosse, le Grand-Vanzay et l'Abbaye. Arrivés à ce dernier point, le Chemin-Vert et le Chemin des Sauniers -se séparaient. Le premier se dirigeait sur Mareuil, en servant de limite à Saint-Jean-de-Beugné, Corps, les Magnils-Reigniers,, passait non loin du moulin de Rassouillet et de Dissais. Arrivé à Mareuil il traverse encore; sous le nom de chemin de grande communication n° 19 de Jard à Coulonges, les communes de la Couture, Rosnay (l'Yon au Gué-Besson), Champ-Saint-Père, Saint-Sornin, les Moutiers-les-Mauxfaits, Saint-Avaugour-des-Landes, Avrillé, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Jard (Beccidcum) et Jard. Le Chemin des Sauniers venant de Poitiers suit, en Vendée, sensiblement le chemin de grande communication n° 35 de Fontenay à Saint-Maixent, franchit le ruisseau de La Prouillc près Saint-Hilaire-des-Loges, traverse la commune de Xanton jusqu'à Beau-Soleil. A partir de ce point il emprunte le chemin de grande communication n° 3 jusqu'à la barrière de Parthenay (ville de Fontenay) et se confond avec le Chemin-Vert jusqu'au Grand-Vanzay, limite Saint-Aubin et Nalliers, passe au pont de Silly (3), laisse Luçon à gauche, rejoint la route des Sables au port de la Claye, sépare la commune de Curzon de celle de Saint-Cyr-en-Talmondais, ensuite la commune de la Jonchère de celles d'Angles et de Saint-Benoît. 1l franchit le ruisseau de Troussepoil, au pont de la Brime, au-dessus du Pé-des-Fontaines, couvert à son sommet de sépultures gallo-romaines, forme ensuite la limite de la commune du Bernard avec celle de Jard, traverse les communes de Longeville, de Saint-Vincentsur-Jard, sous le n° 79 de grande communication, et arrive à Jard, où il se confond de nouveau avec le Chemin-Vert. |
| NOTES: (1) Les Romains avaient encore toutes sortes de voies plus ou moins larges, suivant l'usage auxquelles elles étaient destinées. On les appelait: Via, Iter, Actus, Semita, Callis, Trames, Ambitus, Divortia. Via. - Ces voies publiques avaient en général huit pieds de largeur, sauf celles qui aboutissaient à de grands fleuves, aux ports de mer ou aux villes importantes. Iter, désignait aussi souvent la même chose que Via, et avait autant de largeur. C'était aussi un petit chemin de deux pieds de large où l'on pouvait aller à, pied et â cheval, même en litière. Actus, ètait un chemin de quatre pieds de large, ouvert dans les champs pour le passage des charrettes et chariots nécessaires à, l'agriculture et pour la rentrée des récoltes (*). (2) Tout près de Nieuil, nous avons retrouvé, en 1888, le radier et les piles du vieux pont gallo-romain' qui donnait passage au Chemin-Vert. (*) Louis Brochet.- Une voie romaine traversant Fontenay-le-Comte. (3) M. Bordelais, agent-voyer à Luçon, en a retrouvé la chaussée, il y a environ vingt ans, en faisant construire un chemin vicinal ordinaire sur le territoire de Sainte-Gemme-la-Plaine.
|
| IMPORTANCE DES DÉBRIS
JONCHANT LE SOL DE LA VENDÉE. - ANTIQUITÉS.
|
|
Lorsque l'on parcourt le département de la Vendée (1), on s'étonne de découvrir à chaque pas, tout ce que l'histoire et aussi la nature y ont laissé ou semé de curiosités et de sujets d'études. Pour peu qu'on s'y arrête, il n'est presque pas de bourgade anciennement habitée, qui n'ait autour d'elle ou dans son sein des traces multiples et profondes de civilisations depuis longtemps disparues. Les monuments mégalithiques aux profils informes et gigantesques qui existent encore en grand nombre sur notre sol, donnent à l'esprit, avec leur haute antiquité, la sensation qu'ils n'ont pu se dresser là que sous l'effort des bras d'une population assez dense, et que du moment que cette population existait, il lui a fallu des abris, des lieux de refuge. Que ces abris fussent en bois ou en terre, peu importe ! il n'en n'est pas moins vrai que leurs habitants surent se grouper sur certains points où les générations suivantes sont venues successivement vivre et mourir, avec cette docilité instinctive qui a fait de l'homme l'esclave de l'habitude et de la routine. On peut affirmer qu'il n'y eut jamais de lacune dans la vie de ces petits centres de populations, depuis l'époque de la pierre polie jusqu'à celle où les Romains apportèrent à la Vendée, avec leurs coutumes et leur civilisation raffinée, leurs mœurs corrompues. Au commencement de ce siècle (2), quatre ou cinq gisements gallo-romains au plus étaient signalés sur ce pays de Vendée qui semblait être au bout du monde, déshérité et ignoré. On semblait croire que les légions romaines avaient foulé le sol de notre département, sans y laisser aucun vestige matériel de, leur passage. Aujourd'hui plus on cherche, plus on explore, plus on découvre à chaque pas, l'empreinte de, la civilisation romaine qui s'était infiltrée partout dans les plaines, dans les îlots de l'ancien golfe des Pictons, sur les hautes collines et jusqu'au milieu de l'Océan.
Partout existent, soit apparents, soit latents, dans cette vaste enceinte, des souvenirs et des indices matériels de cette civilisation qui suivait pas à pas pour s'y fixer et y fleurir, les aigles romaines, partout où elles pénétraient. En tous lieux, comme une charrue puissante, elle a labouré notre sol et y a laissé des traces de son passage et de son influence. L'époque de la défaite est si éloignée, que le ressentiment en est pour ainsi dire étouffé sous le poids des siècles, et que c'est presque avec orgueil, que l'on exhume ces impérissables souvenirs de la domination romaine, qui excitent à juste titre la curiosité de l'archéologue (3). Notre contrée est donc intéressante à plus d'un titre, embellie encore par la magique poésie des souvenirs que nous allons essayer de faire revivre dans les pages qui suivent. |
| NOTES: (1) Ancien Bas-Poitou. (2) En 1802, on avait trouvé à Pont-Habert, près Challans, des ruines d'un édifice gallo-romain (Voir Statistique Cavoleau, pp. 391-92, etc.). Vers la mètre époque, on avait rencontré à Saint-Georges-de-Montaigu, des vestiges de l'occupation romaine. (3) Fillon, de Rochebrune, Baudry et documents personnels.
|
|
ÉTAT SOCIAL A L'ÉPOQUE
GALLO-ROMAINE.
|
|
La plupart des classes sociales indépendantes chez les anciens Pictons, se retrouvent sous la domination romaine, mais singulièrement modifiées. En dehors des patriciens et des curiales se forment de nouvelles couches sociales, grandissent des hommes de la plèbe qui, enrichis par l'industrie et le commerce, deviennent eux aussi des notables, et héritent de l'influence que possédaient autrefois les seuls chevaliers. Ils ont laissé, de nombreux monuments funéraires avec des inscriptions et des bas reliefs qui témoignent de leur luxe. Sur ces monuments, dont quelques-uns existent encore à Benet, figurent les ancêtres du tiers-état français ; le maçon avec sa truelle, le forgeron avec son marteau, le sabotier à son établi, le peintre en bâtiment avec son pinceau, etc. Un marchand de vin est assis fièrement en costume de travail, ayant à côté de lui sa femme parée de ses plus beaux atours. Les deux stèles ou cippes trouvées à Benet dans la propriété de M. Tristan, sont surmontées de frontons triangulaires, vierges de toute inscription tumulaire. Sur la base de l'une est gravé en relief le croissant de Diane, et sur celle de L'autre, une sorte de pomme de pin. Deux acrotères devaient probablement se trouver au-dessus des chapiteaux qui supportent le couronnement. La stèle la mieux conservée a une largeur de 0 m. 58 et une hauteur totale de 1 m. 35. Dans une niche semi-circulaire elle contient l'effigie en buste d'une femme dont les cheveux sont disposés de manière à former un bourrelet en torsade autour du front : c'est du reste la coiffure dont on retrouve beaucoup d'exemples dans les effigies de femmes romaines. Une sorte de tunique décolletée embrasse la poitrine sur laquelle elle paraît fixée à l'aide d'une bande triangulaire. La taille est serrée à la ceinture par un cordon, et les manches paraissent fortement étoffées. De la main droite elle tient une bouteille à long col, sorte d'ampulla, et de l'autre un vase à boire ou poculum. Deux de ces poculum se trouvent sous le buste de la femme ce qui tendrait à faire croire qu'elle faisait le commerce des liquides, d'autant mieux que les cippes étaient presque tous revêtus d'ornements ou emblèmes faisant allusion à la profession du défunt. La deuxième stèle, d'une hauteur totale de 1 m. 10 pour une largeur de 0 m.. 5M, était posée sur une pierre formant soubasserrent, dans laquelle on l'avait encastrée. Elle présentai sensiblement une section demi-circulaire. Dans la niche presque carrée, est représenté à mi-corps et en bas-relief, un homme dont les traits sont loin d'être aussi bien conservés que ceux de la femme. La partie supérieure des épaules seule émerge avec-la tête, au-dessus du bloc, dans lequel a été creusé la niche : aucun attribut n'existe (1). |
| NOTES: (1) Louis Brochet. - Chez les Gallo-Romains du pays de Maillezais. Vannes, imprimerie Lafolye, 1891
|
|
|
| LES TONNELLES ET LES LAMPES DU BAS-POITOU |
|
Les Tonnelles, sortes de petites tours monolithes, naguère éparpillées sur toute l'étendue de notre département, placées généralement à côté de bourgs, ou villages d'origine ancienne, ou dans les directions qui y aboutissaient, 'couronnaient presque toujours des hauteurs. Sur la route de Grues à Lairoux, existe encore une tonnelle dite Tour-des-Fées. Cette tonnelle, une des mieux conservées du pays, a près dé quatre mètres de hauteur son élévation au-dessus du niveau de la mer est de 20 mètres. Sa construction, d'après Benjamin Fillon, paraît remonter au IVe siècle, ainsi que celle de Moricq. Il n'entre pas dans notre pensée de nous inscrire contre l'opinion du savant vendéen : il nous suffira de faire remarquer qu'antérieurement à cette époque, devait probablement exister au même lieu, un monument remontant aux âges préhistoriques, car, au mois de septembre 1892, M Lièvre, le savant archéologue de Poitiers, et nous, avons trouvé, au pied de la tonnelle, des silex dits " amandes de Chelles ", et divers autres objets de l'époque solutréenne ou. magdalénienne. Quelques auteurs pensent que ces Tonnelles, fort nombreuses sur le territoire de la Vendée, à en juger par le nom des ténements, servaient à transporter de la côte à l'intérieur, des signaux de jour et de nuit, en vue d'un danger venant de la mer, ce qui ferait remonter leur construction à une des époques où les Saxons ravagèrent la Gaules c'est-à-dire, sous Posthume ou sous les successeurs de Constantin.. D'aucuns prétendent que ces débris de construction ne seraient autre chose que des restes de moulins à pivot dont l'existence est signalée, croyons-nous, pour la première fois en 1105 nous nous rangerions assez volontiers à cette dernière opinion. Si le mode d'affectation des lieux dits Tonnelles, est controuvé, il n'en est pas ainsi de ceux appelés : Lampes, Lanternes, Falots, Petits-Feux, dont quatorze, relevés par M. Bitton, s'échelonnaient sur l'ancien golfe des Pictons, placés à une distance maxima de 15 kilomètres du littoral, et de 20 kilomètres environ les uns des autres. Trois autres sont plus enfoncés dans l'intérieur des terres. Ces lampes ou phares, construites près des bords de la mer, ou sur des points élevés des côtes, servaient à l'entretien des feux allumés pendant la nuit, et de repères aux navigateurs, en les avertissant, soit de la présence d'un passage difficile, soit d'une rade ou d'un port. A l'origine, on se contenta d'allumer au sommet de ces tours, des feux de bois ou de charbon, des torches de résine, ou bien encore des mèches plongeant dans l'huile ou dans le suif. C'étaient sans doute des lampes de ce genre, dont le savant M. Bitton a retrouvé la trace sur les points suivants (1).
1. Commequiers. - La Lampe à la Brigassière, altitude 20 mètres, distance de la côte 5 k. 500. 2. Saint-Hilaire-de-Talmont. - La Lampe à la Savoire, altitude 20 mètres, distance de la mer 7 k. 3. Saint-Julien-des-Landes. -- Le Falot à la Guyonnière, altitude 46 mètres, distance de la mer 10 k. 4. Saint-Vincent-sur-Graon - Le Petit-Feu à la Tuandière, altitude 70 mètres, distance de la mer 15 k. 5. La Bretonnière. - Le Petit-Feu à Mortevieille, sur un petit promontoire environné de marais alimentés par les eaux du Lay, au fond d'une anse, communiquant avec le golfe. 6. Péault. - La Lampe au Poiré, altitude 25 mètres, distance de la mer 5 k. 500-. 7. Les Magnils-Reigniers. - La Lampe à Beugné, sur les bords du même golfe. 8. Sainte-Gemme-la-Plaine. - La Lampe au moulin de ce nom, sur la route de Luçon, altitude 20 mètres, distance de, la mer 3 k. 540. 9. Le Poiré-sur-Velluire. - La Lampe à la hutte de ce nom, sur le bord du marais. 10. Fontenay-le-Comte. - La Lampe près la Ruine à l'altitude de 20 mètres, et à 5 kilomètres environ-du golfe. 11. St-Médard-des-Prés. - La Lampe à peu de distance de la précédente, à la même altitude et à la même distance. 12. Montreuil-sur-Mer. - La Lampe à l'est du village, altitude 20 mètres, et à 2 kilomètres du golfe. 13. Sainte-Christine. - La Lampe au sud-est du moulin, à l'extrémité du promontoire et à une faible distance du golfe. 14. Nieuil-sur-l'Autise. - Champ de la Lampe. En dehors de ces `quatorze points placés sur l'ancien lac des Deux-Corbeaux, des anciens géographes, se trouvent : 1. Sigournais. - La Lanterne près du Requère, altitude 80 mètres, distance de l'ancien golfe environ 27 k. 2. La Châtaigneraie. - La Lampe au Pré-Bailly, altitude 108 mètres, distance de l'ancien golfe environ 26 k. 3. Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine. - La Lampe à Braignard, altitude 84 mètres, distance de l'ancien golfe environ 19 k. Le profil des altitudes indique nettement que l'élévation de ces divers points est en raison directe de l'éloignement des bords de la mer, et que lampes devaient concourir à un même but, obéir à un même ordre d'idées (2). |
| NOTES: (1) Depuis la rédaction de cet article, nous avons trouvé la base d'un de ces phares, au lieu dit Saint-Martin-du-Gué-de-Velluire, sur le bord même de l'ancien golfe des Pictons. La nature des matériaux employés indiquait clairement la fin du ni- ou le commencement du IVe siècle. C'est sur ce point que fut établie la première paroisse du Gué. (2) Pour plus de détails (voir l'Annuaire de
la Société d'Emulation- de la Vendée, année
1886, pages 1 à 19.)
|
|
|
| AGRICULTURE, INDUSTRIE, ÉTAT
DES ARTS, VILLAS,
THERMES OU BALNÉAIRES, CIMETIÈRES, ETC.
|
|
Les Bas-Poitevins s'étaient vite assimilé les mœurs et la civilisation plus avancée de leurs vainqueurs (1) ; l'agriculture se développait, le commerce renaissait, les habitants de la région qui constitue aujourd'hui une partie ~de l'arrondissement des Sables-d'Olonne sillonnaient de leurs barques la mer des Pictons. A: cette époque notre pays, selon toute vraisemblance, commençait à con- naître le noisetier, l'abricotier, le châtaignier, le prunier, le pêcher etc. L'industrie gallo-romaine était en progrès, et sur beaucoup de points de la Vendée des découvertes établissent d'une façon certaine que dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, l'industrie du fer était prospère à la Ferrière, à la Vergne de Saint-Hilaire-des-Loges, à Mervent, et que celle du verre y était en grand honneur sur plusieurs points, notamment dans la forêt de Vouvent, où en 1889 et 1890, nous avons découvert plusieurs fours, remontarit aux ne et me siècles (2). Dès le ne siècle, sous la monarchie des Antonins, et plus tard sous Posthumus, Lollianus, Victorinus, Marius et Tétricus, Pendant le règne desquels la Gaule fut pour ainsi dire indépendante, toutes les magnificences du midi avaient envahi notre contrée. Aux sanctuaires des forêts avaient succédé des temples magnifiques'- à Champorté près Pouzauges, à Saint-Michel -Mont-Mercure, à Bouin, à Saint-Georges-de-Montaigu, - et aux maisons de terre et de bois, avaient succédé les maisons de pierre et de marbre. Les hommes considérables ont dans la cité leur maison d'hiver et dans les campagnes des villas magnifiques, des curtis, coin, prenant outre la maison seigneuriale, de véritables villages occupés par de nombreux artisans, où le luxe de la richesse, le bon goût, et même une certaine poésie charmaient l'existence de ceux qui venaient chercher un abri contre les préoccupations ou e ennuis de la cité.
Ces villas, qui sous la première race de nos rois deviendront la demeure de quelque noble franc ou appartiendront au fisc royal comme à l'Hermenault, Thiré, Grues, Saint-Nicolas-de-Brem, Antigny, Petosse, Payré-sur-Vendée, Saint-Gervais, Noirmoutier, etc., (3) sont souvent pourvues de thermes ou balnéaires comme ceux de Noirmoutier, que nous décrirons plus loin, .et dont l'aménagement et la richesse sont pour nous un sujet d'admiration. Ces villas sont cachées au bord des eaux, à l'ombre, des forêts (4), au flanc des collines, au fond des vallées les plus reculées, et les fouilles entreprises depuis 50 ans en Vendée, notamment par MM. de la Brière, Piet, de Sourdeval, Audé, Fillon, Brethé, Baudry, Mandin, etc., ont établi qu'il en existait sur plus de cent points aujourd'hui connus. Dans maints tombeaux de cette époque, au Mazeau, à l'lsleaules-Vases, à Saint-Denis-du-Payré, à Nalliers, au Langon, à Dompierre, à Saint-Georges-de-Montaigu, à la Bernardière, à Saint-Médard-des-Prés, et ailleurs, on a trouvé de nombreux objets en verre de l'époque gallo-romaine, fabriqués en Vendée et dont' l'ensemble annonce un sentiment artistique très développé. Dans la villa de, Saint-Médard-des-Prés, découverte en 1845, et dont l'atrium reconstitué figure dans notre dessin, on a trouvé des couleurs, des bronzes, des mosaïques et des vernis. Des peintures murales, qui ornaient cette riche habitation, pourraient bien faire honte à. quelques peintres décorateurs de nos jours. On y remarque surtout des sujets ayant trait aux divinités des eaux. 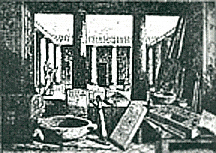 Instruments de peinture découverts à Saint-Médard
(Atrium restauré de la villa)
(D'après une eau-forte de M. de Rochebrune) Dans l'angle sud-est de la sépulture, on a trouvé un
coffret en fer très oxydé, de 0 m. 25 de longueur, 0
m. 15 de largeur et 0 m. 10 de hauteur. Il renfermait, mêlés
à un peu de terre amenée par l'infiltration des eaux Ces divers fragments, possédés par MM. Charier, Jousseaume, de Fontenay, etc., dénotent une grande habileté et-se rapportent au IIIe siècle. Un mouvement considérable dans les arts de la Gaule se produisit sous Posthumus, dont certaines - monnaies seraient aussi très; supérieures comme sentiment de l'art, à ce qui se faisait alors en Italie. Les bains romains, découverts à Noirmoutier, semblent se rapporter à l'époque du grand mouvement dont nous venons de parler. Il n'est, pas jusqu'aux potiers poitevins qui, ainsi que nous le verrons, _n'aient laissé avec leurs marques de fabrique, divers objets de la même époque. L'ancienne côte des, Pitons, depuis Benet jusqu'aux limites du pays de Retz surtout, est littéralement garnie de substructions romaines. |
| NOTES: (1) Cependant, la langue latine ne pénétra que difficilement dans les contrées où les Romains n'étaient qu'en petit nombre. D'après Sidoine Apollinaire, la langue gauloise était encore parlée au centre de la Gaule à la fin du Ve siècle. Néanmoins, de ce vieux langage de nos pères dans lequel ils n'ont rien écrit, il ne nous est resté au plus que trois cents mots gaulois parmi lesquels : allouette, arpent, balai, baraque, baton, bec, bêche, bijou, bouleau, bourde, boyeau, braise, branche" brique, broche, brouille, bruit; brusque, bruyère, cabane, carrière, casaque, cep, dune, échine, fol, galant, haleine, jambe, lieue marne, narguer, orgueil. pic, raie, soc, vache, tan, trou, truc, etc. (Histoire de France pour tous, page 49,) (2) Louis Brochet. Les Fours à Verriers de l'époque Gallo-Romaine. - La, Forêt de Vouvent, son histoire et ses sites. (3) La maison seigneuriale de Petosse se nommait La Court, mot indiquant que la création de cet important domaine remonte au moins à l'époque mérovingienne. En 1903 Petosse dépendait' de l'abbaye de Maillezais. (4) L'abbé Auber, dans son Histoire du Poitou, T. i, page 402, dit que les grandes forêts de la Vendée virent plusieurs fois les rois mérovingiens se délasser, par de grandes chasses à courre, des soucis et des agitations de la politique ; nous pensons que l'affirmation de l'honorable chanoine n'est rien moins que certaine.
|
| ARRONDISSEMENT DES SABLES-D'OLONNE
|
|
La portion de Saint-Hilaire-de-Talmont qui longe la côte; est couverte de pans de murs romains, surtout aux abords de la mine de plomb sulfuré argentifère de l'Essart. On les rencontre particulièrement au' village des Hautes-Mers et au, Veillon, où le hasard fit découvrir, en 1856, entre autres choses, un trésor composé de bijoux en or et en argent, et de 25 à 30,000 monnaies d'argent ou de billon. Dans le champ de la Poizerie, l'abbé Baudry a constaté l'existence du couloir d'une villa de 38 m. 57 sur 3 m. 60, aboutissant d'un côté à un mur de 9 mètres et de l'autre. à. un mur de plus de 70 mètres de longueur. Ce couloir conduisait à'- une salle de bain de 2 m. 90 sur 2 m. 12. Les dunes ont englouti aussi la plupart des villas de, Longeville. Des fragments de colonnes et d'autres débris gallo romains trouvés à la Touche, prouvent qu'un, établissement de cette période existait autrefois sur l'emplacement du hameau. A Saint-Sornin on a trouvé aussi avec les restes d'une villa, un grand carré maçonné avec soin et revêtu de ciment. Au Bernard, à Troussepoil, substructions considérables de l'époque gallo-romaine. Au chef-lieu, c'est une villa dont les fondations convergent autour du clocher, et un établissement de bains. Cet établissement (1) mesure 22 mètres du fourneau à l'aqueduc qui lui est opposé. Sa longueur totale y compris les salles dont il est entouré, et dont une n'a pas moins de 13 mètres, est d'environ 50 mètres. Sa largeur est à quelque chose près la même. L'établissement est double, et forme deux compartiments complets
l'un pour les hommes et l'autre pour les femmes. A Troussepoil, l'abbé
Baudry a fouillé quatre corps de bâtiments, dont un de
22 mètres de long sur 19 de large. Le plus considérable
couvre 20 ares de terrain et est divisé en quarante compartiments
environ. Dans l'une des constructions, on a rencontré l'ocre
rouge, le rubrica des anciens, à trois états différents
à l'état brut, à l'état de peinture dans
de larges terrines, à l'état de petit pain coulé,
portant l'empreinte du sceau et destiné après l'offrande
qui en était faite à la divinité à servir
de spécifique contre la maladie. Le même abbé Baudry pensait que des fouilles bien, conduites à la Touche-Grignon, commune d'Angles, amèneraient des découvertes d'un haut intérêt (2). Il convient encore de citer parmi les villas les plus importantes trouvées dans l'arrondissement des Sables, celle de Beauvoir et ses thermes, décrits par le savant curé du Bernard, et aussi celles de Noirmoutier, Curzon, Saint-Sornin, Champ-Saint-Père, Saint-Urbain, Saint-Gervais, etc. Nous allons dire quelques mots sur les fouilles de Troussepoil, près du Bernard. |
| NOTES: (1) Il existait aussi des thermes, dans l'emplacement de l'ancien cimetière de Sallertaine, où on a rencontré une épée romaine, des pots, des figures allégoriques, etc. (2) Extrait d'un mémoire de l'abbé Baudry. - Congrès archéologique dé France, année 486-1, pages 263-268.
|
|
NOTES SUR LES FOUILLES DE TROUSSEPOIL
|
|
Parmi les objets trouvés par l'abbé Baudry, dans les puits funéraires (1) de Troussepoil plusieurs étaient. symboliques. Les cadeaux de noix, d'après Catulle, se rattachaient aux cérémonies du mariage. On en a trouvé en terre blanche déposés dans un tombeau, avec une lampe, près de Bourbon-Lancy. Le Chêne, on le sait, était consacré à Jupiter, le myrte à Vénus, le laurier à Apollon, le pin à Cybile, et le peuplier à Hercule. Cybile était en particulier invoquée pour la santé, et l'on tirait des pignons du pain, qui était son arbre favori, une amande oléagineuse dont on faisait des émulsions tempérantes ... La figurine de Vénus trouvée à Troussepoil mesurait 0 m. 15 des pieds à la naissance de la tête. Elle fut coulée dans un moulé à deux faces, et représente Vénus nue par derrière et par devant. Par derrière, elle rappelle- celle de Rome, dite Callipyge ou la déesse aux belles fesses (2). La figurine de -Troussepoil est en terre blanche et d'origine gauloise... Les figurines qui n'appartiennent pas à l'art gaulois sont généralement rouges. Il est vrai que dans le principe, au témoignage de Lucain, les cérémonies religieuses n'avaient lieu dans la Gaule, qu'à l'ombre des grands arbres ; mais plus tard, personnifiant les objets de la nature, les Gaulois créèrent des images symboliques qui traduisaient mieux leurs croyances et les aspirations de leur âme. C'est ainsi qu'à la suite de leur contact avec les Romains ils adoptèrent les figurines que ceux-ci avaient, empruntées eux-mêmes aux Etrusques. M. Tudot a trouvé dans la vallée de l'Allier, un certain nombre d'ateliers de figuristes, avec les matériaux propres à la fabrication, c'est-à-dire l'argile, le bois et les moules. L'expérience lui a appris que l'usage des statuettes dans la Gaule centrale, date de la fusion du culte importé par les latins avec la religion des Gaulois.
L'habile administration des premiers empereurs, dit-il, accéléra cette fusion, et prépara cette ère de prospérité, de `calme et de grandeur qui marque le ne siècle. " Dans une des fosses sépulcrales on a trouvé notamment une très jolie 'coupe ressemblant par son galbe, sa capacité et ses motifs de décoration, à celle trouvée à Jard il y a quelques années dans le jardin de M. Potier et déposée au musée de la Roche-sur-Yon. Les moules des courants, des feuilles et des frises sont les mêmes dans les deux. Il n'y a qu'une différence, c'est que les oiseaux qui figurent dans les cercles concentriques sur celle de Jard, sont remplacés à Troussepoil par deux personnages de face plusieurs fois répétés, alternant avec des courants de vigne. Ces deux personnages sont debout et s'appuient l'un et l'autre sur une lyre placée au milieu d'eux. L'un, imberbe et presque nu, a la main droite posée sur le sommet de la tête et représente Apollon ; l'autre, plus âgé. et vêtu, est sans doute quelque lyriste célèbre du nie siècle (le vase est de cette époque). Ces sortes de 'coupes se donnaient ordinairement en prix, à la suite d'un concours, au musicien qui avait remporté la palme sur ses rivaux. Dans cette hypothèse, elle aurait été attribuée à l'un de ces hardes de Troussepoil qui réjouirent si longtemps des mélodies de leur lyre, les échos aujourd'hui silencieux des trois collines (tria podia), et seraient descendus avec lui dans la tombe, brisée en signe de douleur (3). |
| NOTES: (1) L'existence des puits funéraires a été,
il y a quelques années, violemment attaquée par M. Lièvre,
bibliothécaire de la ville de Poitiers, et une polémique
assez vive a même été échangée a
ce sujet entre le contradicteur et les héritiers de MM. Baudry
et Ballereau. Tout en professant la plus sincère estime pour
le savant M. Lièvre, dont les théories paraissent séduisantes,
nous devons faire observer que de Nadaillac, dans son ouvrage : Moeurs
et Monuments des peuples préhistoriques, admet l'existence
des puits funéraires. Dans le Bulletin de la Société
archéologique de Bordeaux, Tome XX, 3' et 4é fascicules,
a paru un article sur le cimetière gallo-romain de Saint-Martin,
â Ravenac, où est de nouveau agitée et résolue
dans le sens de l'opinion de l'abbé Baudry, la question des
puits funéraires. (Bulletin de la Société des
Antiquaires de l'Ouest. (2) Le savant antiquaire du Bernard estimait, avec un écrivain catholique, M. Tudot, que " si l'archéologie a droit de parler ainsi de vénus, c'est parce que le sentiment élevé de l'art purifie tout. " (3) On sait que les Gaulois avaient la musique en si grande estime qu'elle leur semblait venir du ciel, et qu'elle était presque uniquement cultivée par un corps spécial connu sous le nom de Voles, qui appartenait à la hiérarchie sacerdotale. Le nom de PATERNVS, qui avait sa fabrique sur lés bords de l'Allier, étant inscrit sur la coupe de Jard, il est probable, d'après Benjamin Fillon, que celle de Troussepoil a la même provenance. Extrait de Rapport sur les puits funéraires de Troussepoil par l'abbé Baudry. Annuaire 1868-69
|
|
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
A NOIRMOUTIER
|
|
En 1863 et 1864, des fouilles faites par M. Piet, à Noirmoutier, sur le plateau de Saint-Hilaire, du sommet duquel l'œil domine toute l'île et embrasse la haie de Bourgneuf, avec les côtes de l'ancien pays de Retz jusqu'à l'embouchure de la Loire, amenèrent la découverte des restes d'une villa gallo-romaine et d'un balnéaire. A l'époque où ces établissements furent construits, la mer remontait jusqu'au village de Luzay, et formait ainsi, au midi, un petit golfe navigable, communiquant avec le hâvre de Luzan, et à peine éloigné d'un kilomètre de Saint-Hilaire. Au nord, le rivage du Viel, distant d'environ 500 mètres, offrait un port sûr et commode, où le sensuel Romain pouvait prendre les bains de mer et se livrer au plaisir de la pêche. Enfin, l'existence de forêts voisines venait ajouter à ces avantages l'agrément de la: chasse. C'est dans cette position favorable' que sont situées les ruines des bains romains dont nous allons parler sommairement (1). Dans un des compartiments, pavé en béton, le mur sud était revêtu, sur une certaine étendue, de peintures à fresques, où dominait la couleur rouge. Une des salles, de 4 m. 20 sur 2 m. 80, aux murs. recouverts d'une épaisse couche de ciment rouge, renfermait 22 petits piliers brisés à d'inégales hauteurs, faits de carreaux en terre cuite de 0 m. 25 carrés, espacés entre eux de 0 m. 22. Dans la partie ouest, deux bancs de pierre étaient adossés en retour d'équerre à chacun des angles. Nous pourrions, en nous servant dû remarquable rapport de M. Piet, décrire l'ensemble des compartiments mis à jour, mais ce serait sortir des limites du cadre que nous nous sommes assigné dans cet ouvrage. Il nous suffira de dire que l'on y a rencontré toutes les pièces formant un balnéaire romain complet ; la fournaise (hypocausis) sur laquelle étaient placés les vases contenant l'eau destinée aux bains où elle arrivait au moyen de tuyaux conducteurs ; - les étuves (caldaria) disposées de manière que des tuyaux partant de l'hypocausis, introduisaient l'air chaud sous le plancher, par un conduit voûté le bain de vapeur (laconicum), sorte, d'alcôve à demi-circulaire qui, par des tuyaux, recevait de la chaudière d'eau bouillante, des tourbillons de vapeur. La température élevée où cette vapeur brûlante et sans cesse renouvelée tenait la pièce, amenait sur le corps du baigneur une abondante transpiration que celui-ci enlevait avec la strigile, en jetant sur lui l'eau contenue dans un bassin plat (labrum) qui s'élevait du plancher, au fond ou au centre de la chambre ; - un bain d'eau *chaude (alveus 9); - une chambre tiède (tepidarium) tenue à une température modérée qui pré.parait le corps à supporter la transition subite du chaud au froid; - (l'apodyterium) chambre où l'on se déshabillait et où les vêtements restaient déposés pendant qu'on prenait le bain ; - le (frigidarium), ou bain froid, etc. |
| NOTES: {1) Pour de plus amples renseignements, lire le mémoire de M. Piet, paru dans l'Annuaire 1864 de la Société d'émulation de la Vendée.
|
|
OBJETS RECUEILLIS DANS LE BALNÉAIRE
(MÉTAUX)
|
|
1. Une médaille en bronze d'Antonin-le-Pieux (138 de Jésus-Christ), du poids de 11 grammes. 2. Un moyen bronze de Lucille, épouse de l'empereur Lucius Verus (164 de Jésus-Christ), et petite-fille d'Antonio-le-Pieux, comme étant née du mariage de Marc Aurèle avec Faustine-la-Jeune ; poids, 125 grammes. 3. Une porte en plomb, d'une ornementation remarquable, mesurant 0 m. 75 de hauteur sur 0 m. 65 de large et pesant 42 kilos ; elle servait à fermer l'ouverture d'un conduit voûté, à l'effet de retenir l'air chaud introduit sous le plancher des étuves. 4. Une strigile en fer, des clous de différentes espèces, etc.
|
|
|
| OBJETS EN OS ET EN CORNE
|
|
1. Un style (stylus), de 0 m. 11, dont la pointe servait à tracer les caractères sur la cire et le bout plat à les effacer. 2. Une-épingle à cheveux (acus comatoria ou crinalis) de 0 m. 11, que les femmes avaient l'habitude de passer dans leurs cheveux derrière la tête. 3. Une agrafe (fibula) ou boucle de ceinture, avec dessins au trait. 4. Une cuillère. 5. Deux petites flûtes. 6. Des bois de cerf portant encore les clous qui les avaient fixés à la muraille, des défenses de sangliers, etc. On y a trouvé aussi des poteries appartenant à l'ère gallo-romaine et à la période mérovingienne; - divers objets en verre, des morceaux de peintures à fresques, des tuiles à rebords, des tuiles courbes, etc., des briques longues, des poids, des bouts d'amphores, etc.
|
|
|
| ARRONDISSEMENT DE LA ROCHE-SUR-YON
|
|
A Javarsay, de Saint-Philhert-du-Pont-Charrault, appelé Gavarciacum sous les Carlovingiens, était une villa galloromaine. Le village qui touche à l'ancien prieuré porte encore le -nom de Ville pour villa Il y existait naguère des substructions assez considérables avec briques, tuiles à rebords et à crochets. Les constructions antiques ont fait place à un établissement nouveau dit Maison-Neuve (villa-nova). Lors de la reconstruction de la façade de l'église de Chantonnay, il existait encore devant la porte même, un mur de l'époque romaine. On voyait dans le même canton, il y a quelques années, un reste de viaduc. Il était situé sur une voie romaine, à Bourdin, commune de Sigournais, au confluent du-ruisseau de la Bruyère et du. Grand-Lay. Dans la commune de Saint-Hilaire-le-Vouhis, aux abords du Lay, MM. Brethé et Audé ont trouvé des traces d'habitations gallo-romaines importantes, et le premier de ces savants a mis à découvert un de leurs cimetières, à la Créancière, à deux lieues de la Roche-sur-Yon. Le sol de l'antique Durinum renferme un grand nombre de substructions gallo-romaines. A Mareuil, à la Couture, à Dissais, aux Pineaux, à Château-Guibert, les Moutiers-sur-le-Lay, etc., M. Ferdinand Mandin a mis à nu plusieurs villas gallo-romaines et exhumé du sol de nombreux objets de la même époque, armes, bijoux, vases, objets divers, etc. A Chavagnes-en-Paillers, on a fait également des découvertes fort importantes sur lesquelles nous reviendrons .
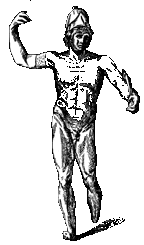 Statuette de Mars, en bronze Toute la partie de cet arrondissement qui borde l'ancien golfe des Pictons, est surtout riche en souvenirs romains. Citons au hasard: A Benet, atrium et stèles déjà m'entionnés, Au Mazeau, indépendamment d'une statuette de Mars, en bronze, : dés montnaies. médailles et objets ro-mains trouvés, vers 1862, on ,a mis à découvert, il y a dix ans, trois cimetières gallo-romains . Dans celui attenant au bourg, on a trouvé une assez grande quantité de sépultures et de vases que nous avons décrits dans la Revue du Bas-Poitou (Nous avons également fait le compte-rendu des découvertes opérées en 1890 à Saint-Denis-du-Payré) (1). - Nieuil-sur-l'Autise, Xanton-Chassenon, Bonneuil, La Vergne, La Bogisière, Grues, Saint-Pierre-le-Vieux, Chalais, L'Hermenault, Auzay, Pouzauges, Saint-Michel-Mont-Mercure, Payré-sur-Vendée, Longèves, Nalliers (2), l'Isleau-lesVases, Civray (3), Saint-Michel-en-l'Herm, Vix, etc., abondent en gisements romains. Le Langon est au point de vue des objets et des souvenirs un des plus riches pays de la Vendée. Fillon appelle, surtout l'attention des archéologues sur un morceau de terre situé en bordure du marais, dans la plaine s'étendant du bourg au village de Pontreau, non loin des Ouches de Saint-Graout ; car il y a là un des plus anciens cimetières chrétiens du Poitou, ainsi que nous l'a appris une précieuse inscription funéraire de la fin du nie ou du commencement du IVe siècle qui y a été déterrée, et dont nous parlons plus loin. Des fouilles et des sondages pratiqués par nous au Langon,
le 23 octobre 1901, dans un pré appartenant au docteur Gourmaud,
sis en bordure de la voie romaine présumée de Nantes
à Saintes, nous ont permis de reconnaître l'existence
de substructions gallo-romaines, s'étendant sur plus de vingt
ares. Il serait on ne peut plus intéressant pour la science,
que des travaux de déblaiement sérieux y fussent entrepris,
pour savoir si l'on se trouve, en présence d'une mansion placée
à l'intersection de deux voies romaines que nous supposons
devoir se réunir au Langon, -, des restes d'une villa,- de
thermes peut-être. L'Erablais et le Braignard, dans la commune de Saint-Martin-Lars, en-Sainte-Hermine, ont été des villas et des fabriques de tuiles et poteries gallo-romaines importantes. Payré-sur-Vendée avait un balnéaire dont MM. Vallette, de Rochebrune et nous, avons, en 1889, retrouvé les conduites, des débris de colonnes sculptées, des fragments de frise en marbre blanc, et en pierre de Tonnerre, des clous, des tuiles à rebords, des traces d'incendie, des aires en ciment, etc. Mais la découverte la plus importante de la région est sans contredit celle faite en 1845, à Saint-Médard-des-Prés par MM. de Rochebrune et sillon, et qu'il nous suffise de dire ici ce que cette découverte, relatée tout au long dans Poitou- Vendée, faisait l'admiration de l'illustre Chevreul. Nous excéderions les limites que nous nous sommes imposé si nous donnions dans ce chapitre la nomenclature détaillée de tous les points du département où existent des vestiges de l'époque gallo-romaine. Nous y reviendrons d'une manière plus détaillée en faisant l'historique de chaque commune. En parlant des invasions barbares, nous dirons également un mot des trésors les plus importants exhumés du sol de la Vendée et dont l'origine est romaine. |
| NOTES: (1) Voir au chapitre n, où nous en reparlerons, la légende et les dessins y afférents. (2) A Nalliers, le Docteur Auger a trouvé un dépôt d'armes, plus de vingt épées en fer, avec petits pommeaux de bronze, des médailles, grand nombre de monnaies consulaires, quelques-unes d'Auguste,' et les plus récentes de Tibère. (3) A Civray, près Maillezais, qui se trouve le long de la voie romaine présu-mée allant de Nantes à Saintes, nous avons recueilli en 1900, un fragment d'inscription ainsi conçu VIA. PRIVAT Cette inscription qui semble remonter au' n° siècle,
pourrait ainsi être traduite d'après le savant épigraphiste
Espérandieu, professeur à l'École militaire de
Saint-Maixent, à qui nous l'avons soumise.
|
| LES CASTRUMS. LES CHATELLIERS
|
|
A côté de ces splendeurs de la vie menée par la riche aristocratie gallo-romaine, les conquérants, pour maintenir leur domination, élèvent, soit sur les côtes de la Vendée, soit sur des points culminants, des Castrums, reconnaissables encore sous leur nom de Châtelliers appliqués à de nombreuses bourgades ou même à de simples hameaux. Castrum à Curzon, à Nieul et à l'Hermenault ; Les Châtelliers-Châteaumur (bourg) ; Les Châ-
telliers d'Auzay Mouilleron-en-Pareds ; Velluire ; Bourneau ; Saint-Michel-le-Cloucq ; Saint-Hilaire-des-Loges ; Pouzauges ; La Chaize-le-Vicomte ; Les Herbiers ; Mouchamps ; Bessay ; Boufféré ; La Bruffière ; Saint-Martin-Lars, La Verrie ; SaintChristophe-du-Ligneron, etc. Ces Châtelliers (1), qui souvent ont pris la place d'oppidums gaulois (2)comme à Mervent, Mareuil,-Châtelliers-Chàteaumur, Bessay, Saint-Vincent-sur-Graon, Pouzauges, etc., deviendront, au moment des invasions barbares, de véritables camps retranchés, où les populations `de tout rang se refugieront avec ce qu'elles ont de plus précieux, tant il est vrai que le malheur commun développe les sentiments de fraternité humaine, ensevelis dans les jours prospères au fond des cœurs. Bien que l'administration romaine eut brisé l'organisation sociale de la Gaule, et que les Druides eussent été proscrits, la vieille nationalité gauloise, dans ses caractères apparents, n'était pourtant pas toute engloutie sous les flots de la civilisation conquérante : elle se réfugiait au cœur du peuple, toujours plus fidèle que les hautes classes aux affections et aux intérêts patriotiques, et surtout plus rebelle aux innovations importées par l'étranger. Elle trouvait asile avec la langue et les religions indigènes, parmi les populations des campagnes, au milieu des bois, dans les forêts d'Aizenay et de la Chaize-le-Vicomte, surtout dans celle de Vouvent, énergique et inextricable foyer du druidisme' et aussi dernier refuge dès industries du verre et du fer qui, même aux époques les plus troublées de notre histoire, furent toujours exercées (3).
Quoi qu'il en soit, pendant quatre siècles, nos pères, absorbés par les intérêts, matériels; éblouis par une brillante civilisation, amollis par-le luxe, acceptent sans trop murmurer la domination de Rome. Par tous les moyens possibles, l'Empire. essaie de faire oublier aux vaincus la perte de la liberté en leur apportant les arts et aussi la corruption de l'Italie. Ils partagent sa bonne et sa mauvaise, fortune, prennent ses mœurs, son langage, suivent à peu près son culte, écoutent ses prêtres, et pénétrés partout par son influence civilisatrice, acceptent son droit quiritaire, le vieux droit de la cité romaine, si étroit, si -exclusif, si dur pour la femme, pour l'enfant, pour l'esclave, pour tous les faibles, mais qui s'était progressivement douci par là large interprétation du préteur " le droit des gens " crée non plus parla tradition, mais par la raison, à l'usage des étrangers de toute origine dont le magistrat romain avait à. juger les personnes ou les biens. Le " droit des gens " s'était élevé à côté du vieux droit romain qu'il tendait à absorber, tandis que lui-même tendait à s'identifier au " droit naturel ",conçu par les philosophes, et à devenir ce qu'on a si grandement nommé " la raison écrite ". Ce droit quiritaire, tombé dans un complet état de décadence pendant les guerres vexatoires des prétendants à l'Empire, et sous la première race de nos rois, a pourtant déposé sur notre sol des germes qui fructifieront plus tard, et nous donneront en 14.71 la première commune jurée du Bas-Poitou, Fontenay-le-Comte. |
| NOTES: (1) Les Châtelliers furent tous des lieux de défense datant en général du IVe siècle. (2) Oppidum veut dire aussi place forte. (3) Louis Brochet. - La Forêt de Vouvent. - Les Fours à Verriers.
|
| INVASIONS BARBARES
|
|
Cependant le moment était venu où le colosse romain devait se briser comme une statue d'argile, et où les dépouilles de l'univers amassées à Rome depuis des siècles, allaient être la proie dé cent nations. Par delà le vieux monde celte-ibère devenu le monde romain, s'étendait le monde immense et indompté du nord, qui devait passer sur les ruines du monde antique, en même temps que la religion de Jésus-Christ, comme ces alluvions terribles et fécondes qui disposent la terre pour les semailles du laboureur. Une force immense, dit Pitre-Chevalier, pousse tous les barbares de la Germanie et de la Scythie contre le monde romain; à pied, à cheval, en chariots, traînés par des cerfs ou des rennes, portés sur des chameaux, bercés sur des boucliers, flottant sur des barques de cuir ou d'écorces, nus, ou couverts de peaux de bêtes, de colliers et de bracelets, chevelus ou rasés, hostoyant épars ou formés en coins, combattant sur les, arbres ou dans les bras de leurs dieux. " Nous ne savons où nous allons ", disaient les Vandales... nous marchons par ordre d'en haut divino jussu. Outre cette impulsion providentielle, un double aimant attirait les barbares, l'or et la femme ; ils se ruaient au pillage de l'Empire comme à une immense orgie. L'enfouissement du trésor du Veillon pratiqué sous Posthume (1), non loin de l'Océan, les nombreux dépôts monétaires trouvés depuis quatre-vingts ans un peu sur tous, les points de la Vendée, notamment à: Port-Juré (2), à Olonne, à Saint-Benoît-sur-Mer, à Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, à l'Ile de Ré,
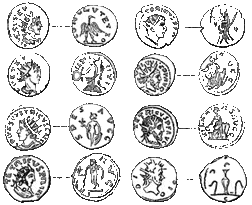 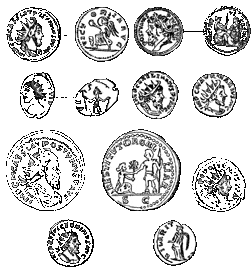 Monnaies romaines trouvées au Mazeau en 1862 et se rapportant
presque toutes
Pendant le règne d'Honorius surtout, une inquiétude générale se répandit dans toutes les cités gauloises. Sous l'aiguillon de la peur et de l'instinct de sa propre conservation " la population de chaque ville, dit M. de Cumont, renversa es plus beaux monuments pour bâtir des murs d'enceinte. Les tombeaux mêmes furent arrachés de leurs bases pour être employés avec les matériaux provenant des temples, des prétoires, à construire des murs de défense, devenus le premier besoin, la première condition d'existence. " Les légionnaires, ne pouvant plus se recruter à Rome ou dans les anciennes provinces,' il fallut, aller, chercher des soldats chez les nations barbares.. Vers la fin du e siècle,' l'Empire prit à sa solde des corps de Goths, d'Alains, de Burgondes, de Francs, et des peuplades entières furent établies comme colonies militaires sur les frontières et jusque dans les provinces de l'intérieur. Les camps de Sauvaget et de Berneveau, situés dans la forêt de Vouvent, sur les bords de la Vendée, furent occupés par les Lètes, barbares à la solde de l'Empire agonisant. Tiffauges, l'Assurie, La Romagne, Mortagne, Marmande Epagnes, Aiffres, tirent leurs noms d'anciennes colonies étrangères importées chez nous à partir de la fin du IIIe siècle (4) Mais rien ne pouvait arrêter le torrent, et l'invasion de 412 balaya les dix-sept provinces de la Gaule, chassant devant elle, comme un troupeau, sénateurs et matrones, maîtres et esclaves, hommes et femmes, enfants et vieillards. La Vendée (Bas-Poitou), eut le sort commun. Elle vit ses florissantes campagnes désolées, ses localités incendiées, ses monuments détruits, ses habitants pressurés par des colonies étrangères. Des Espagnols s'établissent à Epagnes, près de Vouvent, des Scythes à Tiffauges, à Mervent, et sur les confins de l'Aunis, où ils donnent naissance aux fameux Colliberts ou Collibrits de la Sèvre-Niortaise, devenus plus tard les huttiers. D'ailleurs, les traces d'incendie partout visibles parmi les décombres romains exhumés, disent assez les nouveaux maux causés par la guerre civile au déclin de l'empire. Les monnaies de Constantin, de Gratien, de Valentinien et d'Honorius qu'ils recèlent, prouvent toutefois qu'aussitôt ces alertes passées, la population revenait des forêts ou des îles du golfe aux champs qu'elle cultivait. Alors, pendant plusieurs années, il se fit dans notre pays un silence de mort. Sur ces grandes voies où se pressaient les légionnaires et les tribuns à la brillante armure et au fier cimier, on n'entendit plus que les cris des vaincus et des mourants succédant aux chants d'allégresse et de joie. |
| NOTES: (1) Presque tous les dépôts monétaires s'arrêtent au 3e consulat de Posthume. (2) Port-Juré, près du Veillon. (3) Fillon, Poitou-Vendée. Cette opinion n'est
point. partagée par tous les historiens. Le savant M. Caillé
notamment, pense que les Bagaudes du nie siècle ne franchirent
pas la Loire. De son côté, Pitre-Chevalier dit : "
La Bagauderie fut dispersée, mais non détruite par Maximien,
au confluent de la Seine et de la Marne, lieu nommé longtemps
les Fossés des Bagaudes, aujourd'hui Saint-Maurdes-Fossés,
près Paris. " La Bretagne ancienne, page 42. - Du Fougeroux,
dans sa remarquable étude sur Le Poitou pendant la période
Romaine dit aussi e Les populations du Poitou portèrent avec
une triste résignation l'ombre de l'Empire elles ne prirent
point part à la confédération des Bagaudes, tentative
impuissante qui, ne répondant, point a l'opinion: générale,
n'entraîna que quelques cités ".
|
| DÉCADENCE.
|
|
Pendant la longue agonie de l'Empire, au milieu des désordres qui précédèrent et suivirent sa chute, il y eut dans le Poitou, comme dans tout le reste de la Gaule, une diminution de richesses et de population qui s'aggrava par les affreux ravages des Normands, sous la seconde race, et qui ne fut réparée qu'au moyen âge. Le Bas-Poitou, plus exposé par sa position sur les bords de la mer, eut surtout plus cruellement à souffrir. La date de l'envahissement des landes et des forêts sur le sol cultivé dans nos contrées, appartient à ces temps d'anarchie, et ne doit pas être reportée aux premiers siècles de la domination romaine. Nous avons cité les auteurs contemporains ; il y a aussi d'autres témoins qui parlent très haut : ce sont les ruines mêmes faites par les Colons, les Vandales, les chrétiens et les Normands; ces débris' où se confondent les tuiles à rebords, le ciment des Romains, et les pierres rougies par le feu, tristes souvenirs de destructions qui se rencontrent fréquemment sur toute la surface de notre ancien Poitou. Et cependant, ces restes de constructions romaines ne donnent qu'une indication incomplète du nombre des habitations qui existaient alors dans nos contrées. Plusieurs passages de Grégoire de Tours nous apprennent qu'à cette époque et sous la première race, les habitations rurales étaient souvent en planches clouées, suivant le vieil usage gaulois. De pareilles constructions ne portaient pas sans doute la lourde couverture de tuiles à rebords, et la destruction de leurs fragiles matériaux n'a dû laisser aucune trace. A côté des ruines nombreuses que nous retrouvons aujourd'hui, il y en a, donc beaucoup dont le souvenir n'existe plus (1). |
| NOTES: (1) Du Fougeroux.
|
|
CAUSES QUI ONT AMENÉ
EN BAS-POITOU LA DESTRUCTION DES MONUMENTS ROMAINS DANS LES DERNIERS TEMPS DE L'EMPIRE D'OCCIDENT.
|
|
Lorsque les Vandales, dont le nom est demeuré le synonyme du génie de la destruction aveugle et féroce, pénétrèrent en Vendée vers 407, la besogne dévastatrice dont on les accuse d'avoir été les exécuteurs uniques avait été presque entièrement faite : 1° Par les colons et soldats à la solde de l'Empire chancelant qui, pour la construction de camps retranchés (castra), se servirent trop, souvent de matériaux provenant des édifices sacrés et profanes existant en dehors de ces castra ; 2° Surtout par des chrétiens fanatiques. Foulant aux pieds les sages prescriptions des édits de Rome et de Milan, qui concédaient aux chrétiens et aux païens le droit de pratiquer librement leur culte, la religion chrétienne, reconnue comme religion officielle, devint persécutrice après avoir été persécutée. A son tour, elle proscrivit les dieux et les rites romains, et bientôt le marteau s'abattit sur les temples et les statues, la cognée sur les arbres sacrés. Vers 360, saint Martin, ancien soldat, plus tard évêque de Tours, menait énergiquement ces entreprises, et sous ses coups, au dire de l'historien Rambaud, de nombreux monuments périrent dans le Poitou, dont faisait partie la Vendée actuelle.
Il n'existait probablement pas de village qui n'eut, sinon son temple dédié à quelque grande divinité du paganisme ou à quelque patron local, du moins une chapelle, un autel sacré, un bois ou une fontaine, objet de culte et de vénération. Chaque temple avait son. collège de prêtres, dont les fonctions' étaient comptées parmi les grands dignitaires de la cité, et le culte était d'une magnificence dont les traditions et de nombreux détails sont conservés dans l'Eglise chrétienne(1) Pendant tout son épiscopat, qui dura de 371 à 400, il fit, dit Amédée Thierry,' la guerre à la partie matérielle du paganisme. Il fit la guerre à tout ce qui était à ses yeux de l'idolâtrie, aux pierres vénérées, aux temples, aux statues, aux bains qu'il considérait comme indécents (2), aux arbres qui étaient pour les Pictons l'objet d'un. culte particulier, Comme il ne pouvait pas détruire les sources et les fontaines, objet également d'une vénération très grande, il s'établissait dans leur voisinage, et y attirait les campagnards, les- paysans (3) de préférence à tous autres lieux pour les sermonner et leur faire honte de leurs superstitions. C'est ce qui explique probablement pourquoi tant de sources et de fontaines portent son nom Lorsque Théodose renversa pour la seconde fois, en 399, l'autel de la Victoire (4), partout alors les ruines du paganisme achevèrent de disparaître. Partout, dit Charles Dareste, le zèle iconoclaste, enflammé par le- souvenir des anciennes persécutions, ne respecta point les chefs-d'oeuvre de l'architecture et de la statuaire ils furent mutilés, brisés, enfouis dans la terre ou précipités dans les rivières, d'où les fouilles modernes ne retirent le plus souvent que des débris. C'est en vain, qu'au siècle suivant, la voix du poète chrétien Prudence essaya d'arrêter ce vandalisme; et de sauver les derniers et rares monuments qui eussent échappé à la destruction (5). Parlant de cette époque, dans ses Études historiques, Châteaubriand dit": De toutes parts, on démolit les temples, perte à jamais déplorable pour les arts Les temples s'écroulaient, dit le même auteur, à " la voix et sous les mains des évêques et des moines. " Conclusion générale en opposition avec beaucoup d'idées reçues jusqu'à présent, mais que nous croyons devoir indiquer parce qu'elle est l'expression de la vérité, et que la vérité a des droits supérieurs à toutes considérations. C'est aux chrétiens surtout, et non aux barbares qu'il faut imputer la destruction de la plus grande partie des monuments de l'antiquité quelles qu'en fussent la nature et la destination, car dans 'tous ces monuments, ils `voyaient l'empreinte d'une idolâtrie qui leur était odieuse, et dont ils; auraient voulu effacer jusqu'aux moindres traces et souvenirs Il convient même de dire (et c'est triste) que-ceux de ces monuments qui avaient par quelque heureux hasard échappé à la ruine, y demeurèrent voués longtemps après_ l'instauration de la religion chrétienne. Tout le moyen âge; de ses commencements à la fin y travailla. Ne raisonnaient pas ainsi; il faut savoir le reconnaître, le grand saint Hilaire de Poitiers, non plus que le grand évêque d'Hippone, lorsqu'il écrivait à son ami Publicola : " Quand on applique les temples, les idoles et les bois sacrés à dés usages publics, ou qu'on les consacre au culte du vrai Dieu, on agit en cette occasion, comme on a coutume de faire à l'égard des infidèles qu'on amène par la persuasion à la connaissance et à la pratique de la vraie religion. " Mais c'était parler d'or (6). |
| NOTES: (1) Histoire de France pour tous, page 80. (2) Dufour, dans l'Ancien Poitou et sa capitale. dit qu'ils étaient communs aux deux sexes. Les bains scandalisaient l'évêque ; ils devaient, à plus forte raison, scandaliser les chrétiens et les porter â les détruire, ce qu'ils ne manquèrent pas de faire. (3) Voilà pourquoi du mot Paganus ou paysan, on a- fait les mots païen et paganisme. (4) L'autel de la Victoire, cette grande et suprême divinité de la Rome républicaine et impériale, se trouvait dans la curie Julienne, où le Sénat se réunissait. 11 était surmonté d'une statue de cette déesse, conquise sur les Tarentins, au temps de la République. Auguste l'avait orné des plus riches dépouilles. Chaque sénateur en entrant, brûlait un grain d'encens aux pieds de, la vierge gardienne de l'Empire (custos Imperii virgo) et l'Assemblée prêtait devant elle serment de fidélité. (5) Histoire de France, livre ni. Théodose et la ruine du paganisme. (6) Extrait de la Revue -littéraire de la Vendée, par Caillé, ancien chef de bureau au ministère de la guerre.
|
| INTRODUCTION DU CHRISTIANISME
EN VENDÉE
|
|
Au milieu de ces ruines amoncelées, de cette société mourante, des dieux de. Romulus qui ne protégeaient plus la Ville Eternelle, parut tout à coup un principe nouveau modifiant de fond en comble la société humaine, et substituant au vieux culte celtique une religion d'amour qui devait (et c'est un de ses plus beaux titres) affranchir l'esclave, soutenir le faible et faire de la femme, la compagne de' l'homme, son égale, et non pas sa servante. L'abbé Auber, du Fougeroux, et avec eux d'autres écrivains, pensent que le premier apôtre du Poitou fut saint Martial, disciple de Jésus-Christ même, et compagnon de voyage 'de saint Pierre à Antioche et à Rome. Nous estimons que cette opinion est peut-être un peu hasardée. Les seuls renseignements sérieux que l'on possède à ce sujet ne remontent pas au-delà de la seconde moitié du nie siècle. C'est sous Gallien, c'est-à-dire vers 265, que Poitiers aurait eu, son premier évêque, appelé par les uns Nectarius, par d'autres Vietorirlus. Cet évêque aurait été martyrisé à Poitiers, ainsi que beaucoup de chrétiens, dans les arènes dont il ne reste plus que quelques débris (1). Quoi qu'il en soit, presque tous les historiens admettent que-lorsqu'en 312, Constantin fit asseoir le christianisme sur le trône dès Césars, une partie du Poitou était convertie à la religion nouvelle (2). Les seuls monuments authentiques remontant à cette époque, et même aux- IVe et Ve siècles sont fort rares en Vendée, nous en donnons ci-après la nomenclature Le Langon. - Deux petits poissons symboliques en verre, destinés à être portés au cou, recueillis vers 1840 par Benjamin Fillon qui, en 1858, a trouvé au même lieu, en pratiquant des fouilles, les assises inférieures d'un curieux tombeau chrétien de là fin du IIIe siècle ou du commencement du IVe. L'inscription de ce tombeau déposée aujourd'hui au musée de la Roche-sur-Yon est ainsi conçue :
La petite palmette gravée au commencement de cette inscription
ne laisse aucun doute sur son origine chrétienne (3). Le Veillon et Olonne. - Plusieurs pièces de monnaie de l'impératrice Salonine, femme de Gallien, à la légende chrétienne Augusta in pace, trouvées dans le trésor du Veillon, près Talmont, et un petit bronze rare retiré de terre à Olonne, frappé à Constantinople sous Constantin, au type d'Urbs Roma, ayant le monogramme du Christ au-dessus de la louve au revers, peuvent faire supposer que leurs possesseurs étaient chrétiens. Saint-cyr-en-Talmondais. - Trouvé au Marchieul un tombeau chrétien et à Anson une inscription chrétienne du IVe siècle. Angles. - Vase en verre avec le chrisme. Le Tallud-Sainte-Gemme. En 1880, on a' trouvé au Tallud, dans un cercueil de pierre, deux bagues de femme parfaitement conservées. L'une de ces bagues, en argent, porte un monogramme qu'on croit, être une dégénérescence de celui du Christ; l'autre, en bronze, qui, a pu être émaillée, représente parmi divers ornements, deux dauphins reproduits plusieurs fois sur la surface> annulaire. Comme chacun le sait, les chrétiens, des premiers siècles, dispersés au milieu des païens et persécutés par eux, formaient une sorte de société secrète, et un de leurs principaux signes de ralliement était le poisson qui symbolisait, croit-on, la régénération de l'homme par l'eau baptismale Ces bagues chrétiennes, fort rares aujourd'hui, datent des IVe et Ve siècles et sont, elles aussi, comme on le voit, d'intéressants documents pour l'histoire de l'établissement du christianisme en Vendée. Fontenay-le-Comte. - En 1801 on a recueilli à Gaillardon, près Fontenay-le-Comte, quatre inscriptions chrétiennes. Une de ces inscriptions, qui est de la dernière moitié du Ve siècle, et la plus récente de la fin du VIe, nous ont en outre conservé les noms des premiers habitants de cette ville. Jovinus et sa femme ; Pola Rusticus ; Maurolenus (gallo-romain) ; Chagnoaldus (Chaigneau) et Vinoaldus (Vincent), de race franque. Au mois d'octobre 1888, nous avons trouvé dans le quartier Saint-Martin, non loin de l'ancienne chapelle de ce nom, plusieurs tombeaux des Ve et VIe siècles. Foussais. - On a aussi découvert à Foussais un tombeau chrétien que l'on peut attribuer au Ve siècle. |
| NOTES: (1) C'est à la fin du IIIe siècle, sous l'administration de Rictiovare ou Rictus Varus, Préfet du prétoire des Gaules, que l'on place aussi le martyre de Saint Domnin d'Avrillé. (Saint-Domnin d'Avrillé), par l'abbé Rivalland. (2) On prétend qu'il y avait â cette époque, au quartier de la Coupe lasse, de Bouin, un temple du Soleil qui devint ensuite la première chapelle de l'île, vers l'an 300, époque où six femmes de la Basse-Bretagne s'y seraient établies. (3) L'abbé Aillery. Fouillé du diocèse de Luçon.
|
|
APOSTOLAT DE SAINT HILAIRE DE
POITIERS ET DE
SAINT MARTIN DE VERTOU FONDATION DU MONASTÈRE DE DURINUM
|
|
Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que le grand apôtre de a Vendée fut saint Hilaire, appelé à l'évêché de Poitiers à la mort de saint Maixent, luter janvier 353, et sous la présidence duquel eut lieu, vers 355, un concile provincial où furent examinés les obstacles que les habitudes traditionnelles et les poétiques superstitions des campagnes, opposaient à l'introduction du christianisme. Saint Hilaire parcourut une partie de la Vendée, portant partout la bonne parole, et les vingt paroisses placées sous le vocable du grand docteur de l'Eglise sont les témoins irrécusables que son apostolat fut couronné de succès (1). Néanmoins un temps d'arrêt dans les conversions parut se produire, après qu'Eugène et Arbogaste eurent relevé, un moment, les autels des anciens dieux. D'après l'abbé Auber, le culte du paganisme subsistait au commencement du VIe siècle sur certains points de la Vendée ; on y gardait encore le-culte des idoles, et à l'occasion de leurs fêtes sacrilèges, on s'y livrait à des plaisirs désordonnés, à des chants et à des danses qui rappelaient par plus d'un côté les saturnales de Rome. C'est en ce moment-là que naissait celui qui devait compléter en Vendée l'œuvre de conversion au christianisme : Nous avons nommé saint Martin de Vertou. Saint Martin de Vertou, ainsi appelé à cause du monastère qu'il fonda sur les bords de la Sèvre, naquit à Nantes en 527. Entré de bonne heure dans les ordres, il fut chargé par saint Félix, évêque de Nantes, d'évangéliser le pays de Rezé, les îles de Bouin et de Noirmoutier habitées par des pirates saxons, ainsi que les Marches de la Bretagne et du Poitou qui, bien que visitées par saint Hilaire, saint Vicence et d'autres missionnaires, renfermaient des populations retournées au culte du paganisme. Vers 575, il fonde à Durinum (2), un couvent de femmes et
un couvent d'hommes qui deviendront à leur tour autant de
nouveaux missionnaires, Une chapelle dédiée aux deux communautés, et devenue plus tard d'église paroissiale, s'élève alors sur l'ancien forum, et reçoit le nom de Saint-Georges, que le lieu a conservé jusqu'à présent (3). Des voies romaines qui traversent la vieille cité païenne, et par les Deux-Maines, partent des légions de moines qui, d'après les traditions conservées encore aujourd'hui, vont Évangéliser les Herbiers, les Essarts, Mouchamps, Rocheservière, Clisson, Tiffauges, Vendrennes (4). Le 24 octobre 601, le grand thaumaturge (5) mourait à SaintGeorges-de-Montaigu le Bas-Poitou était complètement converti au christianisme (6). |
| NOTES: (1) Saint Hilaire eut comme contemporain à, Poitiers, le célèbre grammairien et professeur Ammonius Anastasius. (2) Aujourd'hui Saint-Georges-de-Montaigu. (3) Cette chapelle dut probablement être superposée à un monument civil et religieux à la fois (Le Forum), qui servit de point de repère aux ingénieurs romains, car les quatre voies venant de Poitiers et de Nantes, d'Angers et de l'Océan s'alignent chacune dessus comme une flèche. Il serait peut-être possible (le retrouver les fondations du monument en question, dédié sans doute à Apollon, l'une des grandes divinités, de la Gaule, dont le culte aura été remplacé à Durinum, comme en une foule 'autres lieux, par celui de Saint-Georges qui, dans la légende chrétienne joue lui aussi le rôle de vainqueur de monstres symboliques. (4) Auber. Histoire du Poitou, T.-ii, p. 211. (5) Ce qualificatif est aussi, et surtout, attribué â St-Martin de l'ours. (6) Pendant l'apostolat de saint Martin de Vertou, se produisirent dans notre pays plusieurs événements importants : - Vers 572, Clovis, le plus jeune des lits de Chilpéric, porte, sur les conseils de Frédégonde, la désolation dans le Poitou L'année suivante, ce malheureux pays est encore ravagé par Théodebert et Mérovée, malgré les instantes supplications de sainte Radégonde ; - En 575, nouvelle invasion de Théodebert. A peine le Poitou commençait-i1 à respirer, que de nouveaux malheurs fondent sur le nord de la Vendée actuelle. Vers 580, la peste, venant de la Bretagne; s'attache aux bords de la Loire, gagne le sol du Bas-Poitou et envahit le pays des Mauges.
|

|

|
| Chapitre Précédent | Table des matières | Chapitre Suivant |